lundi, 31 août 2020
UN PETIT MAIGRET ...
... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.
Les Caves du Majestic.
Trois putains travaillaient dans le temps sur la Côte d’Azur, Gigi, Mimi et Charlotte. Mimi a eu un enfant de Prosper Donge, roux comme son père, mais elle a fait croire à M. Clark, un très riche Américain, que l’enfant est de lui. Etant amoureux, Clark a épousé Mimi. Ils vivent aux Etats-Unis. Au moment de l'action, Donge vit avec Charlotte, en banlieue parisienne et prend son vélo pour aller travailler.
Donge s’occupe de la "caféterie" (c'est le mot de Simenon pour la chose) du Majestic, et rentre le soir à son domicile, où il n’a que le temps de manger en compagnie de Charlotte avant que celle-ci n’aille prendre son service. Le comptable, Ramuel, a passé sa vie à faire des faux en écriture. Il tient un compte très précis de tout ce qui sort de la caféterie en direction des chambres. On apprendra qu'il a écrit des lettres à Mme Clark (Mimi) pour lui demander de l’argent, en imitant parfaitement l’écriture de Donge, le père de l’enfant. Il a pu lire furtivement une des lettres que celui-ci lui avait écrites : c'est cette occasion qui lui a donné l'idée d'une escroquerie rentable.
Mais voyant le couple américain s’installer au Majestic, il craint plus que tout une éventuelle rencontre entre Mimi et Prosper Donge, qui ferait éclater la vérité au sujet des demandes d’argent. Au moment supposé du rendez-vous que les anciens amants s'étaient donné dans le vestiaire du personnel, Ramuel l’étrangle et cache le cadavre dans un box du vestiaire réservé au personnel de l’hôtel. C'est qu'un pneu du vélo de Donge a crevé, ce qui a occasionné un retard de dix minutes (ailleurs dans le roman, Simenon parle d'un quart d'heure).
Donge découvre le cadavre. C’est lui le premier suspect, et Maigret l’envoie en prison, bien qu’il le croie innocent. Justin Colleboeuf, qui travaille aussi à l’hôtel (portier de nuit ?), a assisté au meurtre et menace Ramuel de le dénoncer : ce dernier le tue et pousse le cadavre dans le même placard n°89.
Charlotte, toute seule depuis l’incarcération de Prosper, fait venir Gigi, toujours prostituée, et droguée par-dessus le marché, pour avoir de la compagnie. Ramuel s’apprête à partir pour la Belgique pour toucher ses 280.000 francs, fruit de ses extorsions frauduleuses auprès de Mimi (Mme Clark).
Il s’est fait envoyer les chèques à une adresse fictive, où le courrier était réexpédié à une boîte postale privée acceptant les identités sous forme de simples initiales. Cette boîte est tenue par un drôle de personnage : « un vieux bonhomme répugnant », un « cloporte » (p.269-270). On apprendra qu’il s’appelle Jean-Baptiste Isaac Meyer : il est juif. Simenon a écrit le roman à Nieul-sur-Mer pendant l’hiver 39-40 (voir mon billet du 22 août).
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, les caves du majestic
dimanche, 30 août 2020
UN PETIT MAIGRET ...
... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.
Cécile est morte.
Au début, les collègues plaisantent Maigret au sujet de Cécile, cette jeune femme chargée d'un gros sac qui vient l'attendre en espérant qu'il la recevra.
Juliette Cazenove, qui vit à Fontenay-le-Comte, a un amant du nom de Dandurand, mais elle épouse Boynet, qui apporte l’héritage d’une riche famille. Le couple déménage pour Paris, où il est propriétaire d’un immeuble de cinq étages à Bourg-la-Reine, dont il occupe le dernier.
Mais un jour dans Paris, les deux amants se retrouvent et renouent leur relation. Lui tenait un office d'avoué, mais il a été rayé des listes parce qu'il avait la réputation d'aimer un peu trop les petites filles. Cette fois, Dandurand a à peine proposé à Juliette de supprimer le mari qu’elle approuve : ils vont l’expédier – pas trop vite – en lui faisant absorber régulièrement une petite dose de poison genre arsenic.
Le mari expédié sans conséquences judiciaires, Dandurand vient s’installer dans l’immeuble, mais au quatrième, car ils tiennent à ne pas donner l’éveil et se rencontrent toujours dehors. La particularité de l’immeuble est que l’on entend rigoureusement tout ce que font les voisins, et que Dandurand ne perd donc absolument rien de ce qui se passe dans l'appartement de Juliette.
Celle-ci avait, à la mort de leurs parents, recueilli les trois enfants de sa sœur. « Recueilli » est un bien grand mot : elle a réussi, à force de traitements dégradants, à dégoûter Gérard et Berthe, qui ne supportent pas la vie qu’elle leur fait, mais elle a gardé Cécile, qui est une trop brave fille qu’elle loge et dont elle abuse de la serviabilité. Berthe, de son côté, s’en sort plus ou moins, mais Gérard va de petit boulot en petit boulot et tire le diable par la queue. Or sa femme Hélène attend un bébé.
La tante Boynet fait de drôles d'affaires grâce aux relations peu recommandables de Dandurand : Maigret a eu à faire dans le passé à plusieurs de ces "messieurs" aux costumes rayés et aux bagouses ostentatoires. Dandurand apporte régulièrement des dizaines de milliers de francs provenant de la "collecte" des "loyers", qu’elle garde dans un tabouret bas couvert de tapisserie. Par précaution, la tante fait boire, les soirs de remise, une tisane à Cécile, mais additionnée de bromure qui la fait dormir, pour opérer dans la discrétion.
Or un soir, Gérard est venu demander de l’argent à Cécile, qui n’en a pas, mais qui a caché son frère sous le lit, puis qui lui donne à manger pain et fromage avec un verre de vin, mais aussi la tasse de tisane qui ne lui est pas destinée. Et pendant que Gérard roupille, Cécile entend le micmac des deux complices, entrouvre la porte et aperçoit le « coffre-fort » plein de billets. Quand l’homme est parti, elle vient demander de l’argent à sa tante. Refus catégorique. Cécile l’étrangle.
Dandurand, à l’étage en dessous, a tout entendu. Entrouvrant sa porte, il aperçoit Cécile et Gérard qui s’enfuient après avoir mis dans un sac toutes les paperasses compromettantes qu’ils ont prises dans le secrétaire. Gérard rentre chez lui. Cécile, chargée de son sac volumineux, se rend au quai des Orfèvres où elle veut se constituer prisonnière.
Mais Dandurand l’a suivie, demande à un petit voyou qui est là de lui dire que le commissaire Maigret l’attend, lui fait franchir une porte derrière laquelle Dandurand l’attend, l’étrangle et repart avec le sac. Inutile de dire que l’assassin ne l’emportera pas en paradis.
« Nieul-sur-Mer, hiver 1939-1940 ».
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, cécile est morte
samedi, 29 août 2020
UN PETIT MAIGRET ...
... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.
Maigret se fâche.
Maigret est à la retraite, il fait son jardin dans la maison qu’il habite à Meung-sur-Loire avec son épouse. Arrive une vieille dame en deuil, visiblement riche (voiture avec chauffeur) et habituée à commander. Elle a pris Maigret pour le jardinier. Elle lui ordonne de s’intéresser à la mort de sa petite-fille Monita, apparemment suicidée par noyade, mais elle n'en croit rien. Maigret s’habille et suit docilement cette Bernadette Amorelle, de la maison Amorelle et Campois, énorme entreprise qui règne sur les sablières et gravières de la Seine et diverses autres branches d’activités.
M. Amorelle est mort quelques années auparavant. Maigret descend à l’auberge de l’Ange, à Orsenne, tenue de façon très négligée par Jeanne, aidée de Raymonde, la servante. Il est aussitôt alpagué par Ernest Malik, un ancien condisciple du lycée de Moulins que ses camarades appelaient le Percepteur. C'est manifestement un personnage important de la localité. Malik tutoie d’emblée le policier. Il jouit d’une situation sociale opulente, mais tapageuse : le type même du self-made-man qui écrase les autres de sa supériorité.
L’assurance arrogante de Malik déplaît fortement à Maigret, qui accepte cependant l’invitation à dîner. Malik a deux fils : Jean-Claude, aussi arrogant et antipathique que son père, et Georges-Henry, que son père tient enfermé dans une chambre. L’adolescent était très intiment lié à sa cousine Monita, et peut-être même amoureux d’elle. Il a une sensibilité à vif.
Le lendemain, à nouveau invité à un repas où se trouveront le frère Charles et la belle-sœur (Aimée) de Malik, Maigret a une algarade violente avec celui-ci, qui va même jusqu’à la menace : il lui ordonne de rentrer à Meung-sur-Loire. Maigret, quoiqu'il n'exerce plus de fonction légale, s’empresse de n’en rien faire, à ses risques et périls.
Il apprendra que Malik a épousé la fille aînée de Mme Amorelle, alors que c’était la cadette, Aimée, qui était éperdument amoureuse de lui. Comme elle était trop jeune à ce moment-là, il a, quelques années plus tard, fait venir son frère Charles auprès de lui, un garçon falot, dépourvu de sa superbe assurance, et lui a fait épouser Aimée. Cette désormais belle-soeur lui voue toujours une adoration éperdue, et est prête à tout pour le servir.
Sans aucun scrupule, il a fait des enfants aux deux sœurs, et c’est en apprenant que Georges-Henry, dont elle était amoureuse, était son demi-frère que Monita a décidé de se suicider. Lui est prostré dans la terreur et la haine de son père. Maigret finira par l’apprivoiser avec l’aide de « Mimile du cirque », après l’avoir libéré de sa cave et avoir empoisonné les deux danois d’Ernest. Celui-ci les menace de son revolver, mais finalement les laisse partir.
C’est la vieille Mme Amorelle (quatre-vingt-deux ans) elle-même qui réglera son compte au salopard à coups de revolver. Elle a fini par admirer l’ancien commissaire. On doit le titre à la colère de Maigret devant la veulerie et la lâcheté de Campois, qui dirige théoriquement les sablières Amorelle et Campois, mais qui est en réalité sous la coupe d'Ernest Malik qui le terrorise après l'avoir progressivement dépouillé en douce. Pour empêcher Campois de parler à Maigret, il lui a "suggéré" de faire une croisière dans les fjords de Norvège, et le pauvre homme était en train de s'exécuter bon gré mal gré quand le commissaire s'est imposé.
Roman écrit à « Paris, rue de Turenne, juin 1945 ».
Simenon avait l'écriture facile : dix ou douze romans par an. Il avait minutieusement calibré son temps en fonction de la fabrication de ses œuvres. On peut s'en rendre compte grâce au calendrier annoté en vue de l'écriture de Le Chat (noté "Epalinges (Vaud), 5 octobre 1966") : sept jours pour l'écriture et quatre pour la révision une dizaine de jours plus tard.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, maigret se fâche
vendredi, 28 août 2020
UN PETIT MAIGRET ...
... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.
L'Ombre chinoise.
Oscar Couchet est un campagnard qui voulait réussir et gagner de l’argent. Marié à Juliette, il a longtemps partagé avec elle la vache enragée. Elle en avait marre de cette vie et, côtoyant Edgar Martin, fonctionnaire à l’Enregistrement, elle est devenue sa femme après avoir divorcé. Martin a une situation stable, mais il manque d’ambition en même temps qu’il est très lâche : une vraie larve. Couchet, au contraire, a fini par gagner énormément d’argent à la direction des « sérums Rivière » : il est millionnaire.
Or les laboratoires de l’entreprise sont situés au 61 de la place des Vosges, là précisément où Juliette et Edgar Martin ont leur appartement, et les anciens époux se croisent régulièrement, la femme toisant avec mépris cet homme qui a brillamment réussi. Il a épousé une femme Dormoy, d’excellente famille, et habite pour son compte un très bel appartement boulevard Haussmann. Ils ont très peu de relations.
Couchet a eu avec sa première femme un fils prénommé Roger qui, malgré les efforts déployés par sa mère pour lui donner une éducation, est devenu un propre à rien qui se drogue en compagnie de conquêtes féminines fugitives et tout aussi paumées. Roger finit par se jeter pas la fenêtre de l’hôtel.
A chaque fin de mois, Couchet passe à la banque pour retirer la paie des employés : 300.000 francs en billets neufs (des francs de 1931) qu’il entrepose provisoirement dans le coffre-fort qui se trouve dans son dos quand il est à son bureau. Un jour, la concierge de l’immeuble appelle la P.J. et fait venir le commissaire Maigret pour qu’il constate la mort de Couchet. Il a reçu une balle en pleine poitrine. Le coffre est vide.
C’est Martin qui, au moment où Couchet s’est absenté pour pisser, est entré dans le bureau et a fait main basse sur l’argent. Mais il a oublié un de ses gants sur le bureau, l’imbécile ! C’est ce qu’a constaté Juliette Martin, qui, de sa fenêtre, l’a surveillé et n’a rien perdu de la scène. Elle prend le revolver, descend pour réparer l’étourderie de son crétin de mari. Manque de chance, Couchet est revenu des toilettes. Elle le tue, puis court vers les poubelles pour y dissimuler son arme. A M. Saint-Marc, l'ancien ambassadeur qui fait les cent pas dans la cour en attendant que sa femme ait accouché au premier étage, elle dira être venue rechercher une petite cuillère en argent.
Remontée dans son appartement, elle attend son mari qui, chargé des billets, mais complètement affolé par la situation, ne sait plus quoi faire. Il ne trouve rien de mieux à faire que de jeter les billets dans la Seine. On les retrouvera quelques jours plus tard flottant à la surface au barrage de Bougival. Fureur dévastatrice de l'épouse.
Couchet a rédigé un testament où il demande que sa fortune soit partagée à égalité entre ses « trois femmes » : Juliette Martin, sa première épouse, l’actuelle et la danseuse de cabaret qu’il entretient depuis un an. Maigret fait cueillir Martin au moment où il allait passer en Belgique, où son épouse comptait le rejoindre après avoir hérité. Quand elle se rend compte que Maigret a compris tout le scénario et que tout lui échappe, Juliette Martin devient folle. Elle est conduite à Sainte-Anne, pendant que son mari « sanglotait tout seul dans l’escalier vide ».
Roman écrit à Antibes, aux "Roches-Grises", en décembre 1931.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, l'ombre chinoise
jeudi, 27 août 2020
UN PETIT MAIGRET ...
... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.
L'Affaire Saint-Fiacre.
La comtesse de Saint-Fiacre assiste à la première messe, très matinale, à l’église de Saint-Fiacre, près de Moulins. C’est le Jour des Morts. Maigret est là. Il est né dans la maison du régisseur du château de Saint-Fiacre, régisseur qui n’était autre que son père à l’époque. Le vieux comte de Saint-Fiacre était très attaché aux traditions : pas de whisky dans l’armoire aux alcools. Le domaine occupait deux cents hectares.
Les affaires étaient florissantes. Mais, du jour où le comte est mort, tout a périclité. La comtesse s’est révélée une gestionnaire catastrophique, et les fermes, les terrains, le château lui-même ont été soit vendus, soit hypothéqués. C’est que Maurice de Saint-Fiacre est un bon à rien, qui mène une vie de barreau de chaise à Paris et qu’il réclame sans cesse de l’argent à sa mère, qui lui donne sans compter.
Maigret a reçu de la gendarmerie de Moulins un curieux papier annonçant qu’un crime doit être commis précisément dans l’église, pendant la première messe. Maigret n’a pas quitté des yeux la comtesse, qui était installée dans les stalles en bois du chœur. Rien de suspect apparemment ne s’est produit, et pourtant, à la fin de la messe, force est de constater que la comtesse est morte. « Arrêt du cœur », diagnostique le docteur Bouchardon. On apprend qu’elle avait le cœur très fragile.
L’attention de Maigret est attirée par l’absence du missel que la comtesse tenait dans les mains pendant la messe. Il finit par mettre la main dessus et, à la page du Jour des Morts, il trouve un papier imitant une coupure de journal, où l’on apprend que le comte s’était en réalité tiré une balle dans la tête. C’est cette « information » qui a provoqué l’arrêt du cœur. C’est donc un crime, même s’il n’est pas passible des tribunaux.
Le régisseur actuel, le vieux Gautier, déclare à Maigret qu’il n’a pas cessé de renflouer les affaires du château. Son fils Emile est employé au Comptoir d’Escompte de Moulins. Mais la comtesse entretenait des « relations » avec divers jeunes hommes successifs dont la fonction officielle était « secrétaire ». Jean Métayer était le « secrétaire » actuel, homme désagréable et fuyant. Maurice de Saint-Fiacre n’a rien à cacher, il est franc du collier.
C’est au chapitre X (beaucoup de Maigret se terminent au onzième) que se situe une scène d’anthologie : Maurice a convié tous les acteurs à un grand repas, alors que le cadavre de la comtesse, à l’étage, reçoit la visite de tout ce que la région compte de paysans. Et il se lance en pleine table dans un discours flamboyant, dans lequel il accroche successivement tous les convives (sauf le commissaire évidemment, auquel il ne cesse de faire signe sous la table du bout de la chaussure). Il n’épargne personne.
Il annonce qu’à minuit, l’assassin de la comtesse sera mort. Il a posé au milieu de la table un revolver chargé, à égale distance de tous. A un moment, n’y tenant plus, c’est le jeune Emile qui s’en saisit et qui fait feu. Maurice s’écroule, mais les balles étaient à blanc, et il ne tarde pas à ressusciter.
On aura appris au cours de cette scène formidable que c’est le vieux régisseur qui, au fur et à mesure des ventes, a tout racheté et que c’est donc lui le propriétaire de la majeure partie du domaine. Quant à son fils, c’est lui qui, sur une linotype du journal de Moulins, a composé le message assassin. Alors Maurice se livre sur la personne d’Emile à un cassage de gueule en règle. Quant au gigolo et à l’avocat qu’il avait fait venir (il figure sur le testament), ils s’esquivent sans tambour ni trompette. Pour finir, Maurice de Saint-Fiacre invite les gens présents à l’accompagner dans la chambre mortuaire pour une veillée funèbre autour de sa mère.
Roman écrit à Antibes, au "Roches-Grises", en janvier 1932.
08:26 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, l'affaire saint-fiacre
samedi, 22 août 2020
UN JUIF CHEZ MAIGRET
J'ai emporté un peu de lecture récréative sur mon île déserte.
Georges Simenon a écrit Les Caves du Majestic pendant l'hiver 1939-1940, à Nieul-sur-Mer (Charente Inférieure à l'époque). C'est l'histoire, sordide comme souvent, d'un brave garçon qui se fait piéger par un méchant. Prosper Donge, responsable de la "caféterie" de l'hôtel Majestic, est accusé de deux meurtres : Mrs Clark alias Mimi et Justin Colleboeuf, portier de nuit de l'hôtel. C'est Ramuel, le comptable, qui est le coupable : très doué pour l'imitation des écritures et des signatures, il a mis de côté une somme importante soutirée de Mrs Clark en reproduisant l'écriture de Donge (elle a dit à Clark que l'enfant était de lui, alors qu'il est rouquin comme son vrai père : Donge), et s'apprête à quitter la France pour en jouir. Il se faisait adresser les chèques à une fausse adresse, d'où le courrier était réexpédié dans une boîte postale privée, du genre douteux qui accepte que ses clients se présentent sous de simples initiales. C'est de cette agence qu'il s'agit ici, et en particulier de son "directeur". C'est l'inspecteur Lucas, bien connu des amateurs de Maigret, qui prend la parole. C'est moi qui souligne certaines expressions.
« Regardez ... Vous voyez cette sorte de boutique étroite, entre le marchand de valises et le coiffeur pour dames ? ... C'est ça, l'Agence Jem ... C'est tenu par un vieux bonhomme répugnant, de qui je n'ai pu tirer le moindre renseignement... Il voulait fermer sa boutique et aller déjeuner en prétendant que c'était son heure... Je l'ai forcé à rester... Il est furieux... Il prétend que, sans mandat, je n'ai pas le droit...
Maigret entra dans la boutique à peine éclairée, coupée en deux par un comptoir en bois noir. Des petits casiers de bois, noir aussi, garnissaient les murs, et des lettres emplissaient ces casiers.
– Je voudrais bien savoir ... commença le vieux.
– Si cela ne vous fait rien, grogna Maigret, c'est moi qui poserai les questions. Vous recevez, n'est-ce pas, des lettres à des initiales, ce qui est interdit à la poste restante, si bien que vous devez avoir une assez jolie clientèle ...
– Je paie patente ! se contenta de riposter le vieux.
Il portait des lunettes épaisses sous lesquels s'embusquaient des yeux larmoyants. Son veston était malpropre, le col de sa chemise élimé et gras. Une odeur rance se dégageait de sa personne et devenait l'odeur de la boutique.
– Je désire savoir si vous tenez un registre où, en face des initiales, vous notez le nom véritable de vos clients ...
Le vieux ricana.
– Vous croyez qu'ils viendraient encore ici s'il leur falait donner leur nom ?... Pourquoi pas leur demander des pièces d'identité ?
C'était un peu écœurant de penser que de jolies femmes entraient furtivement dans cette boutique qui avait servi d'officine à tant d'adultères et à tant d'autres tractations malpropres.
– Vous avez reçu hier matin une lettre adressée aux initiales J.M.D.
– C'est bien possible. Je l'ai déjà dit à votre collègue. Il a même tenu à s'assurer que la lettre n'était plus ici...
– Donc, on est venu la retirer. Pouvez-vous préciser quand ?
– Je n'en sais absolument rien et, même si je le savais, je ne crois pas que je vous le dirais ...
– Ignorez-vous qu'il se pourrait qu'un de ces jours je fasse fermer votre boutique ?
– Il y en a d'autres qui m'ont dit la même chose, et ma boutique, comme vous dites, est à sa place depuis quarante-deux ans... Si je faisais le compte des maris qui sont venus faire du bruit ici, et même me menacer de leur canne ...
Lucas n'avait pas eu tort d'affirmer qu'il était répugnant.
– Si cela ne vous fait rien, je vais mettre les volets et aller déjeuner...
Où pouvait déjeuner ce cloporte ? Etait-il possible qu'il eût une famille, une femme, des enfants ? C'était plutôt un célibataire, et sans doute avait-il sa place retenue, sa serviette dans un anneau, dans quelque restaurant miteux des environs. »
Le portrait du tenancier de la boutique ne laisse guère de place au doute. J'avoue que les qualificatifs (vieux bonhomme répugnant, yeux larmoyants, ce cloporte) dont Simenon assaisonne le personnage m'ont mis mal à l'aise et la puce à l'oreille. Il se trouve que, vingt pages plus loin, on a confirmation des craintes lorsque l'individu décline volontiers son identité, au moment précis où il apprend qu'une assez forte récompense sera accordée à ceux qui contribuent à l'élucidation des deux meurtres. Le tenancier, en effet, déclare : « Je soussigné Jean-Baptiste Isaac Meyer ... ». C'est donc bien ça : monsieur est juif. Sa personne est repoussante, et il aime l'argent.
Cette caricature de juif suffit-elle à faire de son auteur un antisémite ? Bon, Simenon a écrit ça pendant l'hiver 1939-1940. Bon, l'air du temps portait à cette époque des odeurs assez fortement antisémites. Bon, Simenon a peut-être eu un moment de faiblesse. Mais quand même ...
Voilà ce que je dis, moi.
Note : On trouve Les Caves du Majestic dans le volume X (les Maigret sont notés en chiffres romains) des œuvres complètes de Georges Simenon publiées par les éditions Rencontre en 1967-1973. Le passage concerné se trouve aux pages 269-270.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, les caves du majestic, juif, antisémite, antisémitisme, roman pollicier
mercredi, 29 juillet 2020
ANGELO
Angelo est une drôle de chose : 140 pages, tout juste un petit roman, et qui, après avoir commencé par une fuite à cheval du personnage, s’achève sur une esquive, ou plutôt sur un départ. Que se passe-t-il entre le début et cette « fin » ? Angelo, après avoir franchi acrobatiquement la frontière française (ah, le « prestige des jambes » d'Angelo lorsqu'il fait sauter son cheval Boïardo par-dessus la barrière, d'une belle détente, sous les yeux médusés du douanier !), abandonne au plus vite son superbe uniforme de colonel des hussards du roi de Sardaigne pour se déguiser en humble paysan.
Il fait bien, car il vient de tuer un important espion de l’Autriche en pays piémontais, le baron Schwarz, une fieffée canaille. On ne peut pas dire qu’Angelo l’ait assassiné : le duel a duré, et la trouée qu’a faite le sabre dans la poitrine montre que ce fut un duel loyal – mais une véritable signature pour le policier venu examiner le cadavre : « Cela n’était pas une comédie de duel. On lui avait longuement permis de défendre sa vie. La blessure unique dont il était mort était singulière pour avoir été faite au sabre qui, dans l’exaltation des combats, mâche toujours un peu les chairs. C’était un coup de pointe, net comme un coup d’épée, qui avait proprement percé le cœur ».
Puis il fait la connaissance, au château de La Valette, du vieux marquis Laurent de Théus, dont il a « protégé » la sœur Céline lors d’un voyage nocturne et périlleux, mais aussi et surtout d’un parfum dont il tombe aussitôt amoureux, au point de dérober le mouchoir où il l’a respiré et de faire confectionner un joli étui pour pouvoir le porter en permanence attaché à son cou. Puis il se fait « adopter » par le vicaire général de l’archevêque d’Aix, ville où il se fait remarquer par son art totalement maîtrisé de monter à cheval et de manier le sabre.
Puis il retourne à La Valette, où il fait enfin la connaissance de Pauline de Théus, la très jeune épouse (vingt-deux ans) du marquis (qui en a soixante-huit). Angelo et Pauline se sont à peine trouvés en présence que le marquis confie au jeune homme une mission confidentielle : « porter une lettre », en lui disant que des gens mal intentionnés se mettraient peut-être en travers de la route. On dirait que Giono se réserve pour plus tard les complexités qu'entraînera l'amour fou entre les deux jeunes gens.
A tous ces gens, il faut ajouter « l’homme au carrick », dont on devine assez vite que c’est un policier, sans doute en mission pour le compte de la Monarchie de Juillet (on est en 1832). Mission utile, mais finalement vaine, puisqu’on apprendra un peu plus tard qu’un coffre officiel contenant sept cent mille francs a été emporté par des conspirateurs, deux gendarmes ayant été tués. Malgré les deux pistolets chargés du policier, dont les coups ne seront pourtant pas perdus pour tout le monde (voir ci-dessous).
L’homme au carrick, qui semble être à tu et à toi avec la vieille Céline de Théus, ne se doute pas que c’est son frère Laurent qui dirige le groupe des conspirateurs légitimistes, qu’il est diablement efficace et qu’il lui a flanqué, au cours des événements de la nuit, deux balles dans le corps (mais dans le dos). Le marquis a été sauvé par un médecin et sa fille d’une noyade certaine, et passe quelques mois dans leur maison jusqu’à guérison complète.
On a compris peut-être que c'est cette fille du médecin qui est devenue la marquise de Théus. Elle raconte à la vieille Céline toute la scène du sauvetage et la suite au cours d’une scène passionnée. Céline veut à tout prix savoir de quoi il retourne avec cette toute jeune femme aux grands yeux qui a épousé son frère on ne sait comment, et lui demande d’expliquer par le menu. Mais elle tombe des nues, à la fin de l’explication (qui dure jusqu’au matin), en apprenant tout ce qui est arrivé à son frère. Céline disparaît ensuite du paysage : elle a rempli sa fonction narrative, elle n’est plus nécessaire à l’auteur.
Angelo fait encore, incidemment, la connaissance des "bergers" du marquis, vingt gars qui montent bougrement bien à cheval et qui s’exercent dans leur "bergerie" à casser des bouteilles vides à coups de pistolet. Le "troupeau" de moutons, aux dires du marquis, est dans la plaine et n’attend que le moment de monter à l’estive. Un des bergers, qui a manié le sabre, se mesure quand même à Angelo, mais demande grâce très vite, devant la science que celui-ci possède dans le maniement de l’arme. Pauline n’a rien perdu de la scène. Pas besoin d’insister pour savoir à quelle sorte de bande on a ici affaire.
Je retiens encore le passage où Angelo, ayant sollicité l’enseignement de monsieur Brisse, le maître d’armes le plus renommé de la ville, finit par se mesurer à lui dans deux assauts quotidiens où il a demandé au vieux maître – qui avoue qu'il n’a plus rien à lui apprendre – de ne pas le ménager, et où celui-ci lui montre des choses qu’il n’a jamais incluses dans son enseignement.
Au total, un drôle de livre, donc, aux airs tant soit peu inaboutis, mais diablement intéressant quand même. Angelo est le type même du héros stendhalien. Les voltes et figures qu’il fait exécuter à sa monture, et qui suscitent tout l’intérêt des dames et la jalousie de leurs galants, me font penser à des scènes de Lucien Leuwen – à la différence que Leuwen se ridiculise un jour en tombant de cheval, juste sous les fenêtres de madame de Chasteller. Il est vrai qu'il se rattrape largement, en brillant un soir de tous ses feux au cours d'un bal, où le lecteur comprend que Stendhal revêt son héros de toutes les séductions. Nul doute que Giono entoure son Angelo d'une sollicitude identique, avant qu'il soit embringué dans la terrible histoire du choléra (Le Hussard sur le toit).
Le héros stendhalien possède une grâce dans les manières qui le fait admirer de tous. Même le marquis, qui en a vu des vertes et des pas mûres, est soufflé par ce jeune homme, naïf si l’on veut, mais qui a surtout besoin de grandeur dans ses actes, ce qu’il accomplit avec une « honnêteté », une sincérité sans égales : « Mais votre loyauté est sans mesure », lui dit-il. Et ça lui convient, à lui qui n'aime pas tout ce qui se mesure.
Un livre plein de charme.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, stendhal, lucien leuwen, cycle du hussard, cycle d'angelo, le hussard sur le toit, marquis de théus, pauline de théus
jeudi, 18 juin 2020
L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 3
 Qui est « L’Absente » ?
Qui est « L’Absente » ?
L’iris de Suse, cette fleur qui n’est pas une fleur mais un os improbable dans le squelette d’un improbable rongeur ("rat d'Amérique"), n’est pas la seule énigme que pose ce grand [le dernier] livre de Jean Giono. Les commentateurs se disputent aussi au sujet du personnage de « l’Absente » et de sa "signification" profonde dans l’ordonnancement du roman. Je dis tout de suite que je n'apporte aucune réponse à ce genre de question. Mon propos est seulement de replonger dans ce roman pour mettre un peu d'ordre dans mes impressions de lecture, une lecture longuement réitérée.
Tringlot, le bandit en fuite, croise le chemin de l'Absente à la page 100 de l’édition "blanche" de Gallimard : « Il suivait un petit chemin entre des haies quand, à un détour, il se trouva en face d’une femme. Elle était au milieu du chemin, debout, immobile, le regard lointain. Tringlot la salua. Elle ne répondit pas ; elle ne manifesta même pas qu’elle le voyait ; or, Tringlot fut obligé de la contourner pour passer et de la frôler (le chemin était étroit). Elle était jeune et jolie ». Voilà, les présentations sont faites. Le lecteur ne saura rien des traits de son visage, rien de sa taille, rien de sa silhouette et presque rien de sa tenue vestimentaire. Pire : dépourvue de nom et de prénom, elle n'a pas d'identité. Elle est quelqu'un en négatif si l'on veut. Et pourtant qu'est-ce qu'elle existe !
Une fois revenu à l’alpage, quand Tringlot lui raconte sa rencontre avec l’Absente, Louiset le met au courant de toute l’histoire, de l’origine jusqu’à l’incroyable et grandiose mariage avec Murataure sous les auspices de la baronne : « Tout le monde connaissait l’Absente ; c’est la nièce des Curnier. Ils ont un bistrot à la croisée des chemins, au-dessous de Châteauneuf. Cette nièce, orpheline, totalement absente, dans les nuages, on a cru longtemps qu’elle était muette. "Non, avait dit le docteur, elle n’est pas sourde ; elle a même l’ouïe fine, donc elle doit parler." On a tout essayé. On lui a tiré peut-être trois paroles, c’est le bout du monde. Elle n’est pas sur terre ; totalement absente de tout, de la France et de l’étranger » (p.102). Ajoutons que sa vie au bistrot ne fut pas drôle et qu’elle y a subi toutes sortes d’avanies, jusqu’à être vendue à un rémouleur qui l’a « retournée » à ses parents bistrotiers : « Inutilisable, a-t-il dit, verrouillée. A la bonne vôtre, mes enfants.[…] Macache bono, c’est en tôle » (p.102). Bref, elle en a vu des vertes et des pas mûres.
Et voilà que le beau Murataure, petit frère d’Anaïs, cette armoire à glace qui tient la forge familiale, Murataure qui possède la seule automobile de la vallée, voilà qu’il se met dans l’idée d’épouser l’Absente ! Il faut dire que la baronne le fait tourner en bourrique. Il a cru que "ça y était" quand elle a déclaré en public, juste après la mort de son mari, qu’elle voulait danser avec lui et personne d'autre. Elle a embauché le piston de Laugier (qu'on devait entendre dans toute la vallée) et valsé toute la nuit comme une furieuse avec le forgeron pour mieux, à partir de ce jour, lui rabattre son caquet chaque fois qu’il s’approchait d’elle la bouche en cœur. Elle s'y entend, cette femme de « trois sous de poivre », pour faire marcher son monde.
Ne comprenant rien à ce revirement brutal, Murataure finit par décider d’épouser l’Absente. Mais contre toute attente, la baronne applaudit l’idée, remuant même ciel et terre pour donner à la noce le lustre et la magnificence qu’elle mérite. Cela ne saurait mettre un terme à l’incompréhensible passion qui dévorera en fin de compte, après la chute de mille mètres de l’automobile, le couple improbable de la baronne et du forgeron. Casagrande pense qu’ « elle ne cherchait qu’une porte de sortie » (p.227) : « Nous enterrerons comme il se doit ce petit chapeau et sa plume, pour sa crânerie. Nous allons lui faire un cercueil à sa convenance ; il recevra l’eau bénite de toutes les églises et il ira dormir dans le caveau de famille. Il l’a bien mérité » (p.224). Une toque et sa plume : ça vous a tout de suite une autre gueule que "L’Enterrement d’une feuille morte", non ? Une belle farce au nez du monde, d'Anaïs Murataure, du corps ecclésiastique.
L’Absente se retrouve donc veuve, sans avoir jamais été « touchée » par son mari. Heureusement, Tringlot veille. Depuis sa première rencontre, il n’a pas cessé de penser à elle. Je dirai qu’il ne pouvait en être autrement, car si l’Absente a fui le monde social normal, lui aussi est engagé dans un drôle de parcours de fuite. Ayant quitté la bande en emportant le magot, sa première préoccupation est bien concrète : échapper à la poursuite dans laquelle se sont lancés le "Cachou" et les "Clefs" pour récupérer l’énorme butin. Et dans un premier temps, se joindre à la transhumance emmenée par Louiset lui paraît une excellente opportunité à saisir pour s’évanouir dans la nature.
C’est ce qu’il pense quand, après avoir modifié complètement son apparence vestimentaire, il reçoit le chapeau promis par Louiset : « (Il tira un chapeau de sa musette.) Je te donne ce que je t’avais promis. Et attention : c’est un vétéran ; il m’a déjà fait cinq campagnes.
Le chapeau était parfait. « Je suis en train de disparaître, se dit Tringlot (il tâta sa barbe au menton) comme un morceau de sucre dans du café bouillant. La mort attrape d’abord ceux qui courent ; je ne cours plus ; je traîne les pieds. Je vais peut-être à trois à l’heure, sous mon chapeau et ma barbe, et sous la corporation (qui m’aurait dit que je conduirais des moutons ?) caché sous la montagne » (p.48). Si l’on peut dire, en cherchant à "disparaître", Tringlot se met aux abonnés absents. C’est dès le départ qu’il cherche à s’absenter. Sans même avoir croisé le chemin de la femme ainsi nommée, il voudrait bien se changer en « Absent ». Giono note : « Il tenait à l’invisibilité » (p.194). Ils sont quasiment faits l’un pour l’autre. C’est un destin. C’est une hypothèse.
Alexandre, qui se fait casser la gueule à chaque passage à Mons, a « une sorte de mazurka dans le crâne ». Le « Cachou » et les « Clefs » ? « La mazurka dans le crâne, zéro pour la question. Et zéro pour la montagne. S’ils voyaient un truc comme ça (dans lequel je suis en plein comme un poisson dans l’eau) ah ! là là, ça leur foutrait les foies ! Je comptais aller loin, mais ici, c’est autre chose que loin, c’est ailleurs » (p.49). Voilà exactement où ils se retrouvent : l’Absente est « ailleurs » ? Eh bien lui aussi.
Ce qui est fascinant, dans L’Iris de Suse, c’est que tous les personnages principaux sont voués au cheminement. Louiset, malade, achèvera son parcours de vivant. Casagrande quittera la vallée définitivement. Alexandre enlèvera enfin la nonne de ses amours au couvent des Présentines. La baronne et son Murataure finiront en beauté dans le précipice et le brasier de la voiture. Tringlot, lui, achève un parcours d’accomplissement en trouvant enfin son point fixe (paradoxal) en la personne de l’Absente, qui n’a ni consistance ni apparence, mais qui acquiert, du fait de son Absence même, une présence incomparable. [Commentaire : mais où va-t-il chercher tout ça ?]
On arrive à une scène curieuse, proche du dénouement, dans laquelle il semble se décider à prendre sa décision finale. Cela se passe à l’église de Villard. Suivant la baronne à l’intérieur, il tombe sur une petite "réunion" de celle-ci avec Anaïs Murataure en présence de l’Absente. Après un manège de comédie où intervient la chaisière (« maquerelle de sacristie ») : « Tringlot passa un moment de bonheur parfait. (…) seule, l’Absente apparaissait hors du commun et hors d’atteinte » (p.202).
Casagrande, que Tringlot retrouve ensuite, ne saura rien de tout ça, mais le bandit, une fois au lit bien au chaud (« Tout de suite il s’écarquilla dans la chaleur ») cogite longuement autour de cette femme qui l’obsède. Il imagine toutes sortes de scénarios autour des différentes manières dont se présente son avenir. Il craint pour elle les « moqueries » et autres « regards sales », voire pire, qu’elle soit une « proie » : « Elle ne comprendrait pas, elle souffrirait, sans raccroc, comme une épave » (p.203).
Il la voit tour à tour se perdre dans la nature, se faire abandonner par son mari (ce qui arrive bientôt après, d'ailleurs), mourir de faim ou tout simplement vieillir (après tout, il est possible qu’il ne se passe rien d’embêtant), etc. Et cet étrange et long monologue, où Tringlot se met à la place de l'Absente dans toutes les situations possibles, se conclut encore plus étrangement : « A moins que … puisqu’on est en train de tout admettre, elle restera peut-être la dernière, seule, riche, assiégée, toujours Absente. Alors il faudrait être là, à côté d’elle (il faudra) et la tuer, gentiment » (p.206). Alors ça, je suis dépassé. Qu’en tirent les commentateurs ?
C’est peut-être Casagrande qui devine le fin mot : « Elle va surtout gêner le bonheur général, répondit Casagrande. Tous ces bourgeois de Calais que vous avez vus en grand uniforme, au garde-à-vous, et le petit doigt sur la couture du pantalon répétaient depuis longtemps un tableau vivant. Ils viennent de le présenter enfin devant le public et ils ont reçu le premier prix de composition. Comment voulez-vous qu’ils puissent tolérer désormais, dans leur troupe, quelqu’un qui ne compose absolument pas et qui ne composera jamais ? Pour le moment, Anaïs se roule dans la farine, mais attendons (…) » (p.226-7). L'Absente ne compose pas, elle ne joue aucun rôle : elle EST elle-même, un bloc à prendre ou à laisser. Les autres ne le supporteront pas.
Soit dit en passant, c’est à se demander si Giono, en élaborant le personnage de l’Absente, ne s’est pas souvenu de Bartleby, cette inoubliable création d’Herman Melville, humain à la limite de l’humain et qui finit par mourir de son attitude extrême. Mais l’Absente ne se donne même pas la peine de son lancinant et fascinant refrain : « I would prefer not to » (on n'oublie pas que Giono a écrit un Pour Saluer Melville). Elle est plus intransigeante, elle ne peut pas faire autrement. L'Absente est une Totalité.
Toute cette expérience étalée sur de nombreux mois amène Tringlot à changer radicalement d’existence : il se convertit à l’Absente. Et il met dans la balance tous les arguments sonnants et trébuchants qu’il traîne comme des casseroles : à Villard, il tremble encore quand il croit voir dans la foule le « borsalino violine » qui fait que « son cœur cogna contre ses côtes ». La décision qu’il prend le débarrassera de ses poursuivants : il va s’éloigner de la vallée en train, mais de telle manière qu’une araignée dans sa toile n’y retrouverait ni ses petits ni ses mouches.
Il emprunte toutes les plus petites lignes pour s’éloigner de son nouveau point d'ancrage et arriver au « bout du monde » après avoir suivi un itinéraire inextricable. Une fois à Notre-Dame-du-Bec (Seine-Maritime), il écrit à ses anciens « parrains » (M. Victor et M. Gaston) une lettre identique par laquelle il leur restitue ce butin tiré de tant de larcins criminels, en leur décrivant dans le moindre détail la manipulation qui leur rendra le trésor.
L’extraordinaire de L’Iris de Suse est presque tout entier (pour moi) dans la répétition de deux toutes petites phrases prononcées par Tringlot : « Je suis comblé. Maintenant j’ai tout » (pp.156 et 244). La première fois qu’il dit ça, Tringlot vient en effet de réussir à ouvrir la cachette au trésor fabuleux qui dort dans les entrailles de « La Sambuque », derrière la troisième marche avant le palier (c’est l’histoire du « joint exquis »), un soir de bourrasque qui étouffe tous les bruits intempestifs qui risqueraient de le faire prendre. Et la deuxième fois qu’il les prononce, il est enfin arrivé à bon port, à sa destination finale, prêt à défendre l’Absente contre toutes les avanies possibles. Il est en sécurité, et il peut enfin penser à protéger l’objet de son désir sans autres arrière-pensées.
Jamais, je crois (Balzac ? quoique), je n’ai lu un roman où les personnages principaux apparaissent dans une épaisseur vibrante qui les fait aussi puissamment exister dans l’esprit du lecteur, alors même que l'auteur dédaigne de les décrire, que ce soit par le physique ou par la psychologie : en dehors des moments où Tringlot se repasse le film de sa vie de brigandage (mais ce sont après tout des monologues intérieurs), les personnages de L'Iris de Suse sont tout de parole et d'action. De présence, et quelle !
Voilà ce que je dis, moi.
On peut trouver mes précédents billets sur le livre au 2 juin et au 5 juin.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, tringlot, l'absenterat d'amérique
vendredi, 05 juin 2020
L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 2
2
L’Iris de Suse, qu’est-ce que c’est ?
La réponse à cette question figure pages 212-213 de l’édition « Blanche » de Gallimard du livre de Jean Giono qui porte ce titre. Casagrande, un jour où il profite de son séjour en alpage (il vient examiner et soigner Louiset) pour herboriser dans la montagne, il rapporte dans sa poche un drôle de petit rongeur avec lequel il a, dit-il, « conclu un pacte » (p.138), bien qu’il échoue à l’identifier (ça ressemble à une gerboise, mais seulement à première vue – moi, j'ai vu une gerbille au col Agnel, Queyras).
La grande marotte de Casagrande, dans sa solitude du château de Quelte, c’est la reconstitution minutieuse de squelettes d’animaux. Oiseaux de jour ou de nuit (dont monsieur Hiou, le hibou centenaire du grenier), mammifères carnassiers ou non, tout y passe. Il lie les os, du plus gros au plus minuscule, au moyen de « fil d’archal » (laiton). Il a appelé « rat d’Amérique » le petit rongeur de la montagne, et ça l’occupe beaucoup : « Casagrande s’obstina des jours et des jours, le nez baissé sur le rat d’Amérique ».
Mais, de même que Giono lui-même, qui semble se mettre humblement à l'écoute de ce que ses personnages ont à dire, je préfère laisser carrément la parole à Casagrande (« Je parle beaucoup. J'aime parler », dit-il p.134), même si l’auteur ne s'absente pas complètement, tant le passage entier semble porter l’espèce de clé qui ouvre l’espèce de serrure qui permet d'entrevoir ce qu'il y a derrière la porte secrète du livre :
« On peut dire que je l’ai aimé ce petit animal unique en son genre ; et je lui convenais. Il fourrait son museau sous mon aisselle comme dans sa tanière. Ses petites dents, je les ai toutes dans une enveloppe de carte de visite. Oh ! certains de ses os étaient encore plus minuscules, notamment les tarses et les métatarses. Il me les confiait gentiment ; je les faisais rouler sous mes doigts ; je les comptais. A un moment, j’ai même cru qu’il n’avait que six osselets à la patte antérieure droite, eh bien ! non, tout décortiqué maintenant, je sais qu’il en avait sept ; le septième était un peu érodé ou aplati, c’est pourquoi je ne le sentais pas à la palpation. Non, il est bien complet, ou, plutôt, dans quelques jours, quand je l’aurai remonté, il sera complet. Il était dodu comme une caille. Je lui offrais des noisettes, même carrément du lard. J’ai été obligé de faire fondre toute sa graisse, de la réduire à petit feu, enfin de la passer à l’étamine. J’avais peur de perdre le plus petit de ses os imperceptibles. Tenez : qu’est-ce que c’est celui-là ? Il faut le regarder à la loupe. Ah ! c’est l’os qu’on appelle l’Iris de Suse, en grec : Teleios, ce qui veut dire : "celui qui met la dernière main à tout ce qui s’accomplit", une expression heureuse qu’on ne saurait rendre que par une périphrase. Regardez-moi ça ! Une périphrase ? Et il n’est pas plus gros qu’un grain de sel. Ça sert à quoi ? Mystère, on ne l’a jamais su ; ça ne sert à rien ; en principe sa nécessité nous échappe, dit-on. En tout cas il existe : le voilà au bout de ma pince. Je vais le placer où il doit être, comme l’a voulu Dieu-le-Père, un très vieux Dieu, vieux comme les rues. Voilà, il est caché derrière le maxillaire supérieur. On ne le voit pas, on ne le soupçonne pas, on ne le soupçonnera jamais mais, s’il n’y était pas, il ne serait pas complet. Je ne le sentirais pas complet.
Ce petit salaud, je l’ai cajolé à l’extrême, il peut le dire ! Sa peau ? Je l’ai tournée et retournée comme un gant. Sa chair ? Je l’ai détachée pièce à pièce, jusque dans tous les contours osseux. Ses articulations ? J’aurais pu me servir de ses tendons en guise de fil d’archal. J’ai été attentif à tout, absolument tout. On ne peut rien me reprocher ; mieux : je ne peux rien me reprocher. Ses os ont été lavés et relavés, poncés, huilés, séchés et maintenant reconstruits. Il est devenu un résumé clair et précis ; comme je vous le disais : une sorte de Grande Ourse, d’étoile polaire ».
Pardon pour la longueur, mais je crois que ça valait la peine. Je me demande si le mot important qui organise tout le passage n’est pas « résumé ». Je me rappelle ce passage de Un Roi sans divertissement où Giono prend un détour pour décrire la curieuse relation qui s'est établie entre les gens du village et le capitaine : tout le village, faute de pouvoir exprimer son amitié au capitaine Langlois (29 février en cliquant) trop distant, a reporté sur le cheval de celui-ci sa recherche d'un peu de familiarité : un passage qui sert en quelque sorte de résumé allégorique à ce qui ne peut être exprimé trop directement.
Même chose ici, me semble-t-il, quoiqu’avec une portée « métaphysique » supérieure, quelque chose qui n’est « pas plus gros qu’un grain de sel », et qui ne vise rien de moins que « l’étoile polaire ». C’est au moins aussi ambitieux que Des Canyons aux étoiles d’Olivier Messiaen, ou que « du brin d’herbe au cosmos sans lâcher le fil » de Gébé (L’An 01, p.41). Pensez, un squelette de rien du tout, "unique en son genre", qui met dans le même sac infinitésimal l’infiniment petit et l’infiniment grand, grâce à un os improbable blotti derrière le maxillaire supérieur et dont personne ne sait à quoi il sert, même un mathématicien de la trempe de Cédric Villani n’y comprendrait goutte. Voilà ce que c’est, un « résumé clair et précis ». Et maintenant circulez, nous dit Giono.
Un résumé de quoi, se demandera-t-on ? Casagrande se prend-il pour Dieu ? L’Iris de Suse est-il une métaphore de Dieu ? Le poids de l'impondérable ? La mesure de l'incommensurable ? Le débat fait rage et les interprétations prolifèrent. Visiblement, l'énigme chatouille les imaginaires. D’autant que Jean Giono s'amuse à inventer des voies de garage, affirmant par exemple dans le "prière d’insérer" (et non une "préface", comme le dit Monique Saigal dans une revue savante) de l’édition originale que ce n’est pas une fleur, mais « un crochet de lapis-lazuli qui fermait les portes de bronze du palais d’Artaxerxès ». Mais malgré ce que dit Giono au lecteur pour mieux le fourvoyer, on sait que l’Iris de Suse est une vraie fleur, dûment répertoriée, comme on le voit, par exemple ci-dessous, sur le blog d’Olivier Ricomini (merci à J.-J. Faivre pour le tuyau et au père Ricomini pour l'image).
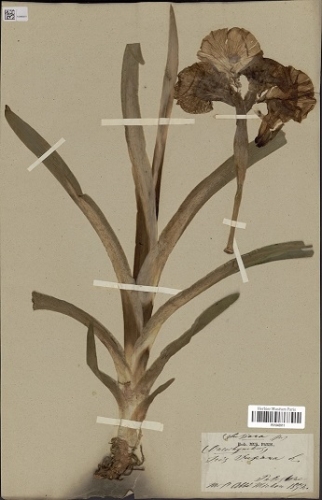
Iris Susiana, collecté par l'abbé Michon en Palestine en 1852, coll. du Muséum National d'Histoire Naturelle.
J’imagine que les mânes de Jean Giono – qui était rusé – se frottent les mains en ricanant, ravies du tour pendable qu'elles ont joué à la postérité, en particulier aux intellectuels qui continuent à se pencher avec gravité sur la question, et à disséquer le problème en hochant et se grattant la tête, à coups de théorie du zéro et autres abstractions oiseuses (voir, entre autres, la notice Pléiade écrite par madame Luce Ricatte, pp. 1020 à 1052 – 32 pages en tous petits caractères : il faut digérer – du vol. VI ; j'ai aussi vu un truc pas triste sur un site "French Review", ou quelque chose d'approchant : je préfère oublier).
S'il y a des abstractions dans l'œuvre de Jean Giono, elles sont diantrement vivantes : il n'est pas un abstracteur. Et ce sont ces "Absentes"-là qui me ravissent, à cause des vibrations.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, grande ourse, olivier messiaen, des canyons aux étoiles, gébé, l'an 01, cédric villani, imfiniment grand, infiniment petit, mathématiques, olivier ricomini, iris susiana, mnhn, muséum national d'histoire naturelle, j.j. faivre, monique saigal, french review
mardi, 02 juin 2020
L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 1
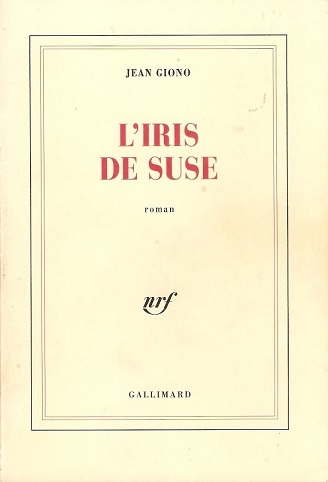
1
J’émerge de la lecture de L’Iris de Suse, dernier roman de Jean Giono, paru en 1970, l’année de sa mort. Le bonheur, comme à chaque fois. Je ne peux pas encore le réciter par cœur, mais je ne désespère pas d’y parvenir un jour. Je viens régulièrement me ressourcer dans ce livre extraordinaire, que je tiens, si la chose a une quelconque signification, pour supérieur à Un Roi sans divertissement. Si je devais choisir un seul livre de Giono, j’élirais sans hésiter L’Iris de Suse : je l'ouvre comme je rentre chez moi.
Pour parler franchement, je n’ai pas d’idée bien claire sur les raisons de cette espèce de passion, et je ne sais pas si j’ai très envie de les disséquer méthodiquement. Je ne sais d'ailleurs pas si je saurais en parler avec un minimum de pertinence. J’ai juste envie d’en conduire une petite causette informelle, au gré de l’humeur et du vent. Je commencerai par les figures incontournables qui donnent au récit son étonnante densité.
Trois hommes occupent le premier plan. Par ordre d’apparition : Tringlot, Louiset, Casagrande. Trois hommes qui ont fouillé la vie de fond en comble et de la cave au grenier et qui ont rapporté de l’aventure trois expériences profondes, très différentes par les circonstances mais fondamentalement identiques en humanité. Trois hommes également imperméables aux fioritures verbales et qui, spontanément et sans bavardage, savent qu’ils sont en phase et qu’ils parlent d’égal à égal, quelque différentes que soient leurs conditions respectives. Trois figures romanesques qui existent puissamment.
Tringlot, c’est l’anti-Capitaine Langlois (Un Roi sans divertissement, Les Récits de la demi-brigade). La trajectoire de l’impeccable capitaine est à peu près celle d’un surhomme qui aurait tout compris de l’existence humaine et de ses misères, et qui se rendrait compte qu’il a beau mettre bon ordre aux malheurs du monde à sa façon expéditive, il fait partie de la commune espèce humaine, ni plus ni moins que le dernier des individus. D’où le cigare fourré à la dynamite. L’histoire de Langlois est celle d'un échec et d’une déception. Voilà ce qui arrive aux amateurs d’absolu : plutôt mourir que renoncer à régner.
Tringlot, lui, c’est un « enfant trouvé ». Il a fait son service dans « le train des équipages ». Et il l’a achevé au bagne militaire de Biribi à casser plein de cailloux. Devenu membre d’une bande de pilleurs de fermes et d’assassins, il fausse compagnie à tous ces complices dangereux en s’appropriant un beau magot, dont un fameux paquet de billets de mille qu’il garde au fond de son sac. Au début, Tringlot est un marginal, un exclu, un fuyard qui craint la vengeance de ses complices. A la fin, Tringlot est devenu un citoyen ordinaire, parfaitement fondu dans le paysage : magie-magie.
Ce que raconte si l’on veut L’Iris de Suse, c’est l’histoire immorale de la rédemption d’un dangereux rebut de la société, déjà coupable de multiples méfaits parfois sanglants, par la grâce de quelques rencontres dues au hasard, puis par le simple enchaînement des faits (enfin quand je dis « simple » …). Pour échapper aux vindicatifs qui le traquent (« monsieur Victor », alias "les clefs", et « monsieur Gaston », alias "les cachous", qui veulent récupérer le butin à tout prix), Tringlot s’engage par hasard dans une vallée des Basses-Alpes.
C’est aussi par hasard qu’il croise la route du berger Louiset, un type qui a de la bouteille dans le métier de berger, qui conduit une grosse transhumance (6000 moutons) vers un coin perdu sous la montagne du Jocond (une vieille connaissance, maintenant), et qui en connaît un rayon sur l’existence humaine. Mais voilà, Louiset souffre, et pas qu’un peu. Tringlot lui vient en aide comme si c’était un camarade, ce qui requinque Louiset pendant un temps et agrège l’ancien bagnard à l’équipe. Voilà Tringlot berger pour quelques mois d’estive (et d'esquive).
Arrivé aux alpages, Louiset demande à Tringlot d’aller à Quelte quérir les services de Casagrande, un homme de science profonde qui lui dira à quoi s’en tenir au sujet de son mal. Quelte, c’est le château des excentriques, où vivent une baronne veuve et fantasque, qui monte à l'occasion la garde devant le château un sabre de cavalerie à la main, et un vieux "philosophe" imprégné de toutes sortes de savoirs et qui passe beaucoup de temps à reconstituer le squelette de toutes sortes de bêtes, occupation dont il dit faire commerce.
Tringlot, Louiset, Casagrande : voilà établi le trépied de bronze sur lequel repose à mon avis tout l’édifice de L’Iris de Suse. Des « caractères » bien trempés. Le point commun de ces trois hommes, c’est qu’ils ne se racontent pas d’histoires, parce que chacun sait que les autres savent. Ils se sont mutuellement jaugés au premier contact. Tout au plus font-ils silence sur ce qu’ils pressentent ou ne veulent pas dire.
Cela fait toute la différence avec les personnages du deuxième rang : le point commun à Alexandre, second berger, Murataure le forgeron et petit frère d’Anaïs, et la baronne de Quelte, cousine de Casagrande, c’est précisément que ceux-ci se racontent des histoires. Tringlot demande à Louiset, au sujet d'Alexandre : « Qu'est-ce qu'il cherche ? – Ce qu'il n'a pas ; comme tout le monde » (p.37). Puis au sujet de la baronne : « Alors qu'est-ce qu'elle cherche ? – Midi à quatorze heures » (p.80).
Cela ne manque jamais : chaque fois qu’Alexandre monte aux alpages, il faut qu’il aille se faire casser la figure dans une ruelle au pied du mur du couvent des Présentines, au-dessus de Mons, et chaque fois on le ramasse dans les orties, bien amoché. Pourquoi persiste-t-il contre toute raison ? Motus, on ne saura rien, surtout de la bouche d’Alexandre.
De même, on ne saura jamais rien de l’énigmatique et scandaleuse passion qui unit jusque dans la mort la baronne Jeanne de Quelte (« deux grains de poivre ») et le forgeron Murataure, un « chic type » (dixit Louiset) qui possède la seule automobile de la vallée (on est en 1904, mais ça n'empêche pas Giono de voir une "Trèfle" de 1923) : on ne retrouvera de leurs corps qu’un "morceau de charbon" et une toque à plume de faisan. Anaïs fera enterrer les restes humains en grande pompe, et Casagrande fera fabriquer pour la toque un cercueil « pas plus grand qu’un coffret à bijoux » et rameutera « le ban et l’arrière-ban du clergé de la montagne » pour faire entrer ce "cercueil" dans le tombeau familial de la chapelle attenante au château.
Chacun de ces six personnages charrie dans son sillage toute une histoire sur laquelle Giono nous livre à peine quelques bribes. Tout juste apprend-on que Louiset est un vétéran de la transhumance et que Casagrande est un immigré italien qui a échoué au château de Quelte sans trop savoir pourquoi là et pas ailleurs à cause d’une vague parenté avec un baron qui s’y est suicidé.
Les monologues intérieurs de Tringlot nous en apprennent davantage sur le personnage qui forme l’armature centrale du roman, dont la boussole se formule : « La Mort n’attrape que ceux qui courent », qui lui sert à la fois de refrain, de morale et de stratégie de survie. Mais L’Iris de Suse flirte avec l’amoralisme le plus franc : Tringlot, ce criminel endurci, est d’emblée sympathique au lecteur. Et la sympathie carrément spontanée qu’il inspire à Louiset et Casagrande n’est pas faite pour atténuer le potentiel positif dont toute la narration nimbe le parcours de ce personnage non conventionnel.
Je l’ai dit : ce livre raconte une rédemption, et cette rédemption, on l’entrevoit au moment où Tringlot, qui remonte un soir de neige vers le château de Quelte sans trop savoir ce qu’il va y chercher, aperçoit soudain, immobile et perdue, debout sur un tertre, l’Absente. L’Absente ? Une trouvaille géniale de Jean Giono. Pensez, un personnage qui n’a ni être, ni visage, ni substance. A peine une silhouette, qui est là sans être là. A peine une silhouette entrevue à travers les flocons d’une tempête de neige. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Tringlot est saisi d'une étonnante colère. Murataure, qui est le mari sur le papier (elle ne se laisse jamais toucher), l’a cherchée partout en voiture et l’embarque.
Alexandre annonce un soir à Quelte la mort de Louiset, et le cocher de la "patache" qui ramène Tringlot lui apprend que Casagrande a quitté le château « avec armes et bagages ». L’Absente de L’Iris de Suse est devenue le but ultime de l’ancien bagnard, qui va, dès lors, se débrouiller pour acquérir enfin la panoplie – costume et statut – de la normalité, de la respectabilité.
Pour cela il doit se débarrasser du fardeau qui lui vaut la haine de ses anciens complices : l'énorme butin accumulé dans « la Sambuque », qu'il a fort habilement soustrait à la bande (première apparition de l'incroyable formule finale : « Je suis comblé. Maintenant j'ai tout ») et qu'il a très ingénieusement dissimulé dans une cache ménagée par ses soins dans « la ferme Longagne ». Arrivé au bout du monde (Notre-Dame-du-Bec) après une trajectoire ferroviaire compliquée à plaisir, il écrit la même lettre à "monsieur Victor" et à "monsieur Gaston" et leur explique comment faire jouer le mécanisme. Ainsi allégé de tout cet or, il peut retourner à Saint-Georges (« ... j'arrive à toute vitesse. Qu'on se méfie ! »).
Il sera le bourrelier de la vallée, mais il sera surtout le défenseur de l’Absente contre les malveillants, à commencer par sa belle-sœur Anaïs : « "Je suis comblé. Maintenant j’ai tout", se dit-il.
Désormais, elle serait protégée contre vents et marées et elle ne savait même pas qu’il était tout pour elle. »
Ce sont les derniers mots.
Peut-être à suivre. Question : au fait, pourquoi L'Iris de Suse ?
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, un roi sans divertissement, capitaine langlois
samedi, 21 mars 2020
L’OCCIDENTAL ET LA NUDITÉ FÉMININE
Des profondeurs de mon confinement, je crie vers toi, Liberté ! En attendant ton Retour, je m'efforce de prendre patience comme je peux.
« Mais entre les choses doublement étranges et vraiment émerveillables, que j’ai observées en ces femmes brésiliennes, c’est qu’encore qu’elles ne se peinturent pas si souvent le corps, les bras, les cuisses et les jambes que font les hommes, même qu’elles ne se couvrent ni de plumasseries ni d’autres choses qui croissent en leur terre : tant y a néanmoins que quoi que nous leur ayons plusieurs fois voulu bailler des robes de frise et des chemises (comme j’ay dit que nous faisions aux hommes qui s’en habillaient quelques fois), il n’a jamais été en notre puissance de les faire vêtir : tellement qu’elles en étaient là résolues (et je crois qu’elles n’ont pas encor changé d’avis) de ne souffrir ni avoir sur elles chose quelle qu’elle soit. Vrai est que pour prétexte de s’en exempter et demeurer toujours nues, nous alléguant leur coutume, qui est qu’à toutes les fontaines et rivières claires qu’elles rencontrent, elles jettent avec les deux mains de l’eau sur leur tête, et se lavent et plongent ainsi tout leur corps comme cannes, tel jour sera plus de douze fois, elles disaient que ce leur serait trop de peine de se dépouiller si souvent. Ne voilà pas une belle et bien pertinente raison ? mais telle qu’elle est, si la faut-il recevoir, car d’en contester davantage contre elles, ce serait en vain et n’en auriez autre chose. Et de fait, cet animal se délecte si fort en cette nudité, que non seulement, comme j’ai jà dit, les femmes de nos Toüoupinambaoults demeurant en terre ferme en toute liberté, avec leurs maris, pères et parents, étaient là du tout obstinées de ne vouloir s’habiller en façon que ce fût : mais aussi quoi que nous fissions couvrir par force les prisonnières de guerre que nous avions achetées, et que nous tenions esclaves pour travailler en notre fort, tant y a toutefois qu’aussitôt que la nuit était close, elles dépouillant secrètement leurs chemises et les autres haillons qu’on leur baillait, il fallait que pour leur plaisir et avant que se coucher elles se promenassent toutes nues parmi notre île. Bref, si c’eût été au chois de ces pauvres misérables, et qu’à grands coups de fouets on ne les eût contraintes de s’habiller, elles eussent mieux aimé endurer le halle et la chaleur du Soleil, voire s’écorcher les bras et les épaules à porter continuellement la terre et les pierres que de rien endurer sur elles. »
Jean de Léry, Histoire d'un voyage faict en la terre du Bresil, (1578, p.231-233).
Note : Il paraît que le "Rouge Brésil" du très médiatique Jean-Christophe Rufin doit beaucoup à Histoire d'un voyage faict en la terre du Bresil. Je me suis résigné à mettre l'orthographe au "goût" d'aujourd'hui. Je n'ai rien changé à la syntaxe. L'auteur est un calviniste pur jus de faucille et marteau, qui en veut énormément à un certain Thevet, salopard de la même époque (un quasi-Trotski), quoique catholique fervent, qui a le toupet de ne pas croire en Dieu de la façon correcte et qui, de ce fait, raconte n'importe quoi. Je n'ai pas lu Thevet. On est très loin de l'histoire délicieuse de Marciole venant livrer de belles cerises au redoutable seigneur De La Roche, que Béroalde de Verville raconte au début de son merveilleux Moyen de parvenir. Là, la religion ferme sa gueule. Elle a intérêt.
Incroyable comme la langue française du XVI° siècle reste pour moi d'une saveur sans pareille.
Voilà ce que je dis, moi.
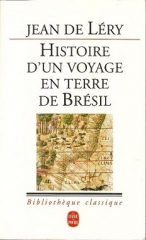
Petit rappel (édition en français d'aujourd'hui) :

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : coronavirus, covid 19, politique, france, littérature, littérature française, jean de léry, voyage au brésil, histoire d'un voyage en terre de brésil, béroalde de verville, le moyen de parvenir
dimanche, 01 mars 2020
ENCRE SYMPATHIQUE

DIALOGUE
« Dis donc, tu sais pas la nouvelle ?
– Non.
– J'ai lu Encre sympathique.
– Le dernier Modiano ?
– Oui.
– Et alors ?
– Rien. »
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, patrick modiano, modiano encre sympathique
samedi, 29 février 2020
UN ROI SANS DIVERTISSEMENT
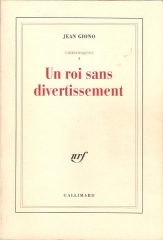 UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?
UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?
Je viens de relire, une fois de plus (je n’ai pas compté combien), Un Roi sans divertissement, de Jean Giono (Gallimard, 1947). Ce roman fait partie de mes rares élus de prédilection dans lesquels je me replonge régulièrement. J’ignore pour quelle obscure raison. Peut-être est-ce parce qu’il se dégage du capitaine Langlois, la figure de proue de l’intrigue, des traînées d’interrogations puissantes, alimentées par la langue fruitée, charnue, pleine d’ellipses et de surprises artistement façonnée par l’auteur. Une langue qui, par-dessus le marché, effleure un essentiel obscur, une sorte de bloc de granit, qu’elle fait pressentir avec une certaine volupté sensorielle, mais qu’elle laisse pour finir absolument impénétrable.
Je crois précisément que l’incroyable force du livre tient à ce qu’il est en soi une question sans réponse. Giono prend un malin plaisir à n’apporter aucun élément qui permettrait au lecteur de se faire une idée, même approximative, de ce qui meut le personnage principal. Les personnages vivent, parlent, agissent fortement, mais jamais l’auteur n’ouvre la porte au lecteur sur leur vie intérieure, sur leur « psychologie », comme s’il n’en savait pas davantage que celui-ci sur les motivations profondes et qu’il ne faisait que lui rapporter ce qu’il a vu ou ce qu’on lui a dit.
Je souhaite d’ailleurs bien du plaisir à ceux qui se hasarderaient à donner à ce personnage et à ce roman une signification précise. Par exemple, j’ignore sur quels éléments du livre le rédacteur de la notice du Nouveau Dictionnaire des Œuvres (Bouquins-Laffont) s’appuie pour déclarer : « Langlois est un homme supérieur qui s’ennuie de façon existentielle ». Dans Les Récits de la demi-brigade (relire La Belle hôtesse), Langlois n’est pas davantage un homme supérieur que dans Un Roi … Il est un militaire, un gendarme, un homme d’action, je veux dire un homme dont l’existence est faite des actions concrètes qu’il est en mesure d’accomplir pour, en obéissant aux ordres, conserver en l’état l’ordre du monde et mettre fin aux méfaits des malfaisants qui le narguent. Même s’il sait en toute conscience qu’il y a des désordres auxquels un capitaine de gendarmerie ne saurait mettre fin (cf. Noël, dans Les Récits …).
S’il finit par se faire sauter le caisson à coups de dynamite, est-ce, comme dit le même commentateur : « pour ne pas céder à la tentation de tuer – en particulier de tuer Delphine » ? Est-ce parce que, lorsqu’il a fait part de sa décision de se marier à la tenancière du café du village : « par jalousie, la vieille Saucisse, connaisseuse », lui a procuré une femme pas assez ardente ? Ce monsieur en sait plus que moi. Était-ce vraiment une femme, même ardente, qu'il aurait fallu à Langlois ? Je n'en sais rien.
Ce qui est sûr, c’est que le capitaine (puis commandant) Langlois, après avoir réglé deux affaires énormes de façon expéditive et spectaculaire (M. V. et le grand loup, même topo : deux coups de pistolet en plein dedans : « Langlois s'avance ; le loup se dresse sur ses pattes. Ils sont face à face à cinq pas. Paix !
Le loup regarde le sang du chien sur la neige. Il a l'air aussi endormi que nous.
Langlois lui tira deux coups de pistolets dans le ventre ; des deux mains ; en même temps.
Ainsi donc, tout ça, pour en arriver encore une fois à ces deux coups de pistolet tirés à la diable, après un petit conciliabule muet entre l'expéditeur et l'encaisseur de mort subite ! »), puis démissionné de l’armée pour s’installer dans le village (jamais nommé : Lalley (Isère), selon le Dictionnaire cité plus haut), ne sait plus vers quel horizon diriger ses pas. Il a éliminé le Mal à deux reprises et rétabli la sécurité dans un village attaqué dans son intimité : et maintenant, quoi ? Le « bongalove » ? Le labyrinthe ? Delphine ? Le cigare du soir au bout du jardin ? Mystère. J’en reste résolument au point d’interrogation : un grand roman sur l’énigme de la vie humaine. Quelle raison de vivre faut-il se donner ? Il y a de la métaphysique là-dedans.
La question me suffit : elle est en elle-même une réponse. Que dit Jean Giono de son personnage ? « Voilà comment il était. Il ne disait rien. Il ne bronchait pas, il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous et, d’un mot, il vous faisait comprendre qu’il savait tout. Et il avait ainsi remède à tout » (p.211 de la collection « blanche » de Gallimard).
Mais Giono a peut-être laissé des indices de ce qu’il a mis dans Langlois en racontant comment son cheval a conquis une place à part dans la vie du village. Ne sachant pas comment le militaire l’appelait, les habitants ont fini par le surnommer « Langlois ». Un drôle de cheval en vérité. Son portrait commence page 85 de la même édition : « Par contre, on devint très familier avec le cheval ».
« Et comme, d’après ce que je vous ai dit, on n’eut guère l’occasion de manifester cette sympathie à l’homme, on la manifesta au cheval. D’autant que c’était un cheval qui faisait tout pour faciliter les choses ». On peut se reporter, par exemple, au début du récit Angelo, pour se convaincre que Giono et le cheval, c’est une histoire d’amour fondée sur une connaissance mutuelle profonde : « Soudain, par on ne sait quel prestige des jambes (…) il fit que le cheval, accroupi comme un chat, se détendit et s’envola par-dessus la barrière » (Gallimard, coll. Biblos, p.6). Le douanier français en reste éberlué.
« Langlois », tout comme Langlois (sans guillemets), a un caractère indépendant : « C’était un cheval noir et qui savait rire. D’habitude, les chevaux ne savent pas rire et on a toujours l’impression qu’ils vont mordre. Celui-là prévenait d’abord d’un clin d’œil et son rire se formait d’abord dans son œil de façon très incontestable. Si bien que, lorsque le rire gagnait les dents, il n’y avait pas de malentendu. La porte de son écurie était toujours ouverte. Il n’était jamais attaché ».
Et ça continue : « S’il reconnaissait quelqu’un qui lui plaisait plus particulièrement il l’appelait d’un ou deux hennissements très mesurés, semblables à des roucoulements de colombe. Et, si celui-là, alors, levait les yeux et lui disait un mot gentil (ce qui était toujours le cas) le cheval s’approchait de lui à pas aimables, très cocasses, très volontairement cocasses, casseurs de sucre et un peu dansants, pour venir poser la tête sur son épaule ».
Bon je ne vais pas abuser de la citation, je veux juste suggérer que, pour avoir une idée (en creux, en biais, en filigrane) du monde intérieur du capitaine Langlois, on peut lire et relire ces quelques pages formidables (85-89), et surtout le paragraphe qui clôt le passage : « Il [le cheval] n’avait qu’un défaut : il était sévère avec les bêtes. Il ne riait jamais, il ne roucoulait pas, ni à un autre cheval ni à une jument. Il ne les regardait même pas. Il les côtoyait, impassible, pour venir vers nous. Il aimait au-dessus de sa condition ». Il aimait au-dessus de sa condition ! Tout est dit : tout Langlois n’est-il pas dans cette phrase ? Dans ce paragraphe ? On peut comparer avec les quelques lignes de la page 211 (« ... il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous ...») citées plus haut.
Il est possible qu’à la prochaine lecture du roman, mon attention soit attirée par d’autres éléments. Pour cette fois, je m’en tiens à ce personnage du cheval, finalement fugitif, et à cette idée que son portrait n’est pas là par hasard.
Quel roman admirable ! Il faut sans cesse relire.
Voilà ce que je dis, moi.
Note 1 : le prochain dans mon collimateur, c'est L'Iris de Suse (1970), dernier roman de Jean Giono, mon préféré, mon favori, que je considère comme indépassable. C'est sûr, pas de la même trempe : dans l'un, l'histoire d'une rédemption, dans l'autre, une course à l'abîme. Dans l'un, Tringlot le hors-la-loi devient un homme ordinaire (la dernière réplique : « Je suis comblé. Maintenant j'ai tout, se dit-il »). Dans l'autre, Langlois fait le chemin inverse : « On est en contrebande, dit-il. En plus de ça, qu'il me dit, il y a des lois, Frédéric. Les lois de paperasse, je m'en torche, tu le vois, mais les lois humaines, je les respecte » (Un Roi ..., p.76).
Note 2 : la chaîne France Culture diffuse en ce moment un feuilleton intitulé Un Roi sans divertissement (10 épisodes). Je ne suis pas allé écouter ce que ça donnait. Ici le premier épisode.
Note 3 : ci-dessous, un fragment de la carte Michelin n°77 : on est dans le sud de l'Isère, tout près de la Drôme et des Hautes-Alpes, non loin du Vercors et du Grand Veymont. C'est là que tout se passe.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, un roi sans divertissement, éditions gallimard, capitaine langlois, giono les récits de la demi-brigade, robert laffont nouveau dictionnaire des oeuvres, la belle hôtesse, l'iris de suse
vendredi, 28 février 2020
GÉRARD PHILIPE ET JÉRÔME GARCIN
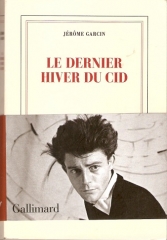 Je viens de lire Le Dernier hiver du Cid, de Jérôme Garcin (Gallimard, 2019). Le journaliste, en écrivant ce livre en hommage au célébrissime acteur Gérard Philipe (mort avant son trente-septième anniversaire) accomplit visiblement un devoir. Mais c’est autant devant la gloire du comédien qu’il s’incline que devant le souvenir de la dépouille du père de son épouse, Anne-Marie, née Philipe, qui avait presque cinq ans à la mort de celui-ci.
Je viens de lire Le Dernier hiver du Cid, de Jérôme Garcin (Gallimard, 2019). Le journaliste, en écrivant ce livre en hommage au célébrissime acteur Gérard Philipe (mort avant son trente-septième anniversaire) accomplit visiblement un devoir. Mais c’est autant devant la gloire du comédien qu’il s’incline que devant le souvenir de la dépouille du père de son épouse, Anne-Marie, née Philipe, qui avait presque cinq ans à la mort de celui-ci.
L’auteur, en vingt-neuf courts chapitres, choisit de raconter les tout derniers temps de l’existence de Gérard Philipe. Disons-le d’entrée : ce livre m’a souvent agacé. D'abord, pourquoi le titre parle-t-il d’ « hiver » ? Gérard Philipe est mort le 25 novembre 1959, c’est-à-dire au cours de l’automne.
Pour moi, c’est une coquetterie, de même que l'usage du mot « Cid » : Jérôme Garcin – et c’est tout à fait intentionnel et systématique – opère tout au long du livre un amalgame permanent entre la personne (Gérard le fils, le mari, le père, l'ami, ...), bouillonnante, exaltée, infatigable, et les personnages (le Prince de Hombourg, Perdican, Ripois, Fanfan la Tulipe ...) que l’acteur a fait vivre sur les scènes de théâtre et sur les écrans de cinéma, à commencer par le plus illustre : Rodrigue.
Pour dire quel acteur exceptionnel il était, le cinéaste Christian-Jaque dit drôlement : « Il jouait si bien que même le cheval croyait qu'il savait monter » (p.16, à propos de Fanfan). Il n'est donc pas question de contester le génie théâtral.
Mais pour ce qui est du livre, le fait que l'acteur a été enterré vêtu du lourd costume qu’il portait dans Le Cid de Corneille n'est pas une raison suffisante pour se permettre de fondre l'homme dans ses rôles. Certes, bien qu’il ait joué des dizaines de rôles au cinéma, au théâtre ou au disque, c’est indéniable, pour toute une génération (et plus d’une), le Cid n'eut pas d'autre visage que celui de Gérard Philipe. Garcin n’est donc pas le seul à identifier personne et personnage. Mais est-ce une raison pour écrire : « Perdican aime suer et se salir dans le mortier et la poussière blanche des gravats » (p.27) ; « Vilar parti, Perdican s’endort » (p.143) ? Qu’est-ce qui lui prend, ailleurs, d’écrire « le Cid va se coucher » (je n'ai pas retrouvé le passage) ? Je me permets de trouver le procédé un peu niais.
Cette volonté de tisser ensemble l’homme et la fonction est certes un choix, mais discutable. Pour moi, c’est plutôt une mauvaise idée qu’un hommage. Il y a là une confusion qui m’a heurté à la lecture. Bon, je relativise en me disant que c'est précisément ce que bien d’autres trouveront formidable. J’ai également été agacé par quelques facéties d’écriture, qui m’apparaissent moins comme des clins d’œil que comme des grimaces : « les tournées, les tournages, le tournis » (p.178) ; « il vogue sur une Méditerranée amniotique » (p.89).
Ailleurs, il parle de « fourbures » (p.87), mot qui appartient au vocabulaire vétérinaire, ce qui n’est pas gentil pour les adultes et les enfants dont il est question : « C’est, pense-t-elle, la vertu des maladies, elles métamorphosent les adultes triomphants en enfants tremblants, dont les mamans font disparaître, avec de longues caresses sur le front chaud, la fièvre, les fourbures, et l’apeurement ». C’est ici l’amateur de cheval qui parle : « Congestion et inflammation du pied des ongulés » (Larousse).
Et il ne peut pas s’empêcher d’oser un zeugma carrément insoutenable de grotesque (« il sourit sous cape et sous son drap blanc » (p.95), sans doute venu de la diarrhée de zeugmas qui a encombré un temps son émission Le Masque et la plume. Enfin, où a-t-il pêché que les poilus étaient équipés d’une "gibecière" : « passés directement du collège à la tranchée, troquant le cartable contre la gibecière » (p.70) ? Bon, plus grand monde ne sait aujourd’hui ce que fut la « giberne » des soldats, mais ce n’est pas une raison : ça reste très bête.
Alors, ce livre, finalement ? Je dirai juste que, en dehors de quelques pages réellement sensibles autour de l’agonie et de la mort du grand comédien, Le Dernier hiver du Cid est un livre dispensable et futile. Je vois surtout à l'œuvre l'insupportable dolorisme larmoyant imposé par l'air du temps, ainsi que la traque inlassable des émotions et affects des lecteurs, ces pestes qui infestent notre époque.
La splendeur intacte de Gérard Philipe n'avait nul besoin de la besogne faussement votive de Jérôme Garcin (né en 1956), même au prétexte qu'il est son gendre post mortem. Jérôme Garcin est un bon journaliste, c'est du moins la rumeur qui court. Est-il un écrivain ? C'est selon moi beaucoup moins sûr.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, gérard philipe, anne philipe, théâtre, le masque et la plume, garcin le dernier hiver du cid, france inter, zeugma, figures de style, éditions gallimard, corneille le cid, rodrigue et chimène, littérature française
mercredi, 23 octobre 2019
LE DÉSHÉRITÉ
LE DÉSHÉRITÉ.
« Je suis Le prince. Ma seule Etoile Porte le soleil Dans la nuit.
Rends-moi La fleur Et la treille.
Suis-je Mon front ?
J'ai rêvé Et j'ai deux fois Modulant Les soupirs. »
***
Faisant un jour lointain mon petit Oulipo dans mon coin, j'avais pondu, entre autres abominations, ce petit quatrain, dont tous les connaisseurs ont déjà reconnu la teneur et l'auteur.
Gagné par une forfanterie ô combien mal venue, j'avais appelé ce petit jeu « Incipit vertical ». Je veux dire que j'avais récrit un des plus beaux poèmes de la littérature française en prenant le(s) premier(s) mot(s) de chaque vers, comme si les autres mots à droite de la forme imprimée n'avaient jamais existé. Cela aurait aussi bien pu s'appeler « acrostiche syllabique » ou « acrostiche lexical ».
Quelques décennies après avoir commis ce forfait, je présente aux pieds des mânes de Gérard de Nerval l'encens et la myrrhe de mon amende honorable, pour lui restituer l'aura de la gloire dont son nom et ses vers n'ont d'ailleurs jamais cessé d'être nimbés.
Pourtant, "ma seule étoile porte le soleil dans la nuit", ça a de la gueule, je trouve.
Bon, c'est vrai, je n'ai fait que me hisser pour cela sur les vastes épaules du grand poète. Dans le fond, je me suis contenté de tricher : on connaît l'astuce du roitelet dans le concours qui devait désigner le roi des oiseaux, et qui s'est posé discrètement avant le départ sur le dos de l'aigle royal, pour s'élever de quelques centimètres au-dessus de lui au moment de sa victoire. D'où son diminutif (dit-on). En matière de poésie, je suis le diminué de ce diminutif.
***
Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé,
Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie :
Ma seule Etoile est morte, – et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.
Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m’as consolé,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie,
La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé,
Et la treille où le Pampre à la Rose s’allie.
Suis-je Amour ou Phébus ?… Lusignan ou Biron ?
Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;
J’ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène…
Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron :
Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée
Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.
***
Nerval au Père-Lachaise (photo prise en 2014).
Note : je suis d'accord pour dire que mon petit truc ne fonctionne pas pour l'entièreté du poème. Vers la fin en particulier, de deux choses l'une : soit il faudrait lire "modulé", soit il faudrait, pour que le mot "fois" s'inscrive un peu logiquement dans la phrase, y voir le pluriel de "foi" (au grand dam des mânes de monsieur Labrunie et de sa "vieille lanterne"). Ce serait tant soit peu "capillotracté". Je persiste cependant à voir dans la première phrase la jolie traduction de l'une des causes du tourment qui tenaillait Gérard. Pensez : une étoile qui porte le soleil dans la nuit ....
J'ai bien essayé d'appliquer ma petite recette à d'autres poèmes français très connus (Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, ...), car j'aurais bien voulu en faire un modèle de contrainte oulipienne autre que celles que l'Ouvroir propose dans ses publications, mais ce fut peine perdue. La grande poésie française résiste à l'oulipianisation.
C'est peut-être justice : "La cimaise et la fraction" (La Cigale et la fourmi passée par la moulinette de la méthode "S + 7" – renommée "n + x") n'est pas une preuve irréfutable du bien-fondé de l'entreprise "Oulipo". La contrainte d'écriture ne donne pas du génie à ceux qui n'en ont pas. Tout le monde ne s'appelle pas Georges Perec.
Pour avoir un aperçu des vingt-quatre premiers membres de l'Oulipo, voir les pages 352-354 de La Vie mode d'emploi. Quand je dis "vingt-quatre", j'exagère : il faut mettre à part le premier : « 1 Tham Douli portant les authentiques tracteurs métalliques rencontre trois personnes déplacées ».
Ma petite tentative porte décidément bien son titre : "Desdichado".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, littérature française, oulipo, ouvroir de littérature potentielle, gérard de nerval, gérard labrunie, rue de la vieille-lanterne, père-lachaise, el desdichado, georges perec, la vie mode d'emploi, la cimaise et la fraction
mercredi, 02 octobre 2019
CÉLESTE ALBARET
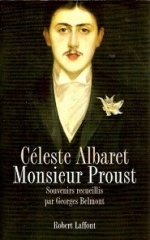 Je viens de lire un livre qui n’a pas de semblable. L’auteur de Monsieur Proust (Robert Laffont, 1973) n’est autre que Céleste Albaret, la femme qui n’a pas quitté l’écrivain pendant ses huit ou neuf dernières années d’existence. Je n’aurais pas lu ce livre si je n’étais pas auditeur de France Culture. La chaîne publique a en effet eu l’idée merveilleuse de diffuser, en une série de cinq émissions estivales de la série "La Grande traversée" (Philippe Garbit pour cette série), de larges extraits de l’interview au long cours (trois mois) que Céleste avait accordée à Georges Belmont en 1972. En fait, Céleste n'a pas écrit un mot du livre dont elle est l'auteur : elle les a parlés.
Je viens de lire un livre qui n’a pas de semblable. L’auteur de Monsieur Proust (Robert Laffont, 1973) n’est autre que Céleste Albaret, la femme qui n’a pas quitté l’écrivain pendant ses huit ou neuf dernières années d’existence. Je n’aurais pas lu ce livre si je n’étais pas auditeur de France Culture. La chaîne publique a en effet eu l’idée merveilleuse de diffuser, en une série de cinq émissions estivales de la série "La Grande traversée" (Philippe Garbit pour cette série), de larges extraits de l’interview au long cours (trois mois) que Céleste avait accordée à Georges Belmont en 1972. En fait, Céleste n'a pas écrit un mot du livre dont elle est l'auteur : elle les a parlés.
Des nombreuses heures (Belmont dit "soixante-dix", le producteur dit "quarante") de bandes magnétiques enregistrées par le journaliste-écrivain, le producteur france-culturiste Philippe Garbit a gardé entre sept et huit (29 juillet-30 juillet-31 juillet-1 août-2 août 2019). Des moments que je qualifie d'exceptionnels.
Je l'avoue uniment, platement, humblement : c'est la voix de cette femme extraordinaire qui m’a donné l’envie d’ouvrir le bouquin qui dormait sur un rayon, avec l'intégralité du contenu des enregistrements. Ce qui est étonnant, c’est précisément qu’on ne se lasse pas de l’écouter, tant sa voix de campagnarde invétérée débarquée à Paris pour cause de mariage (Odilon Albaret, qui était devenu le chauffeur attitré de Marcel Proust), sa jovialité, sa simplicité, sa gouaille, sa présence, son ton parfois péremptoire, ses fous-rires, son enthousiasme sont communicatifs. Lire le livre après ces quelques heures donne l'avantage unique d'accéder en lisant au ton carrément incommunicable sur lequel se passent les entretiens. Quelle bonne femme, Céleste Albaret !

Céleste et Odilon après l'engagement de celui-ci dans les services motorisés de l'armée française en guerre.
Interviewée à 82 ans, morte à 92 (Odilon est mort je ne sais plus quand, d'une crise d'urémie), elle revit devant le micro une expérience absolument unique : avoir tenu compagnie pendant huit années à un des plus grands écrivains de la littérature européenne, au moment où celui-ci décide de se retirer chez lui, à l’abri du monde, pour faire aboutir son grand projet littéraire : La Recherche du temps perdu. Étrangement, cette fille venue de la campagne profonde, qui se levait et se couchait avec les poules, se met, calquant brutalement son rythme de vie sur celui de Marcel Proust, à vivre la nuit et à dormir la journée, au moins jusqu'au réveil du patron, entre 14 et 18 heures selon les jours. Cette brutalité ne semble pas l'avoir traumatisée.
L’expérience l’a marquée tellement en profondeur qu’on peut dire qu’elle ne s’en est pas remise. Elle le dit à plusieurs reprises : elle vouait un véritable culte à Marcel Proust, en qui elle voyait l’incarnation de l'absolu du raffinement, de la haute distinction et de la courtoisie la plus délicate. Qu’on n’attende pas d’elle le plus petit reproche ou la plus petite once de critique : elle a trouvé, au 102 boulevard Haussmann, puis rue Hamelin, une sorte de paradis sur terre, certes gouverné par un tyran domestique, mais devant lequel elle n’a cessé d’être en adoration, et aux moindres caprices duquel elle déférait, soumise et aimante. On ne peut même pas dire qu’elle lui pardonnait ses défauts : à ses yeux, il n’avait pas de défaut. Elle s'est mise à genoux devant la statue au premier moment où celle-ci s'est présentée (de façon rigolote : « sans cravate et sans barbe »), mais l'extraordinaire, c'est que la statue le lui a bien rendu. Céleste Albaret, on ne sait comment, est devenue en peu de temps une composante indispensable du décor de l'écrivain.
Cette fille d’une campagne reculée (Auxillac en Lozère, où sa mère, dit-elle : « faisait la cuisine à l'âtre ») ne savait rigoureusement rien faire de ce qu’un « employeur » est en droit d’attendre. Proust lui-même le lui avait déclaré d'emblée en 1914, quand elle s'est installée à demeure chez l'écrivain : « Céleste, vous ne savez rien faire, mais soyez assurée que je ne vous demanderai jamais de faire quoi que ce soit ». Extraordinaire, non ? Comment est-elle devenue cette dame de compagnie, et même cette confidente littéraire en présence de qui Proust commençait à mettre en forme les observations qu’il rapportait de ses soirées ou de ses repas mondains ? Mystère. Il y a là une rencontre qui tient du miracle. C’en est au point que l’écrivain lui déclare un jour que si elle partait, il ne pourrait pas achever son chef d’œuvre.
Ce qui est sûr, c’est que Céleste existe intensément quand on l’entend dévider ses souvenirs. Mieux que dévider : elle revit puissamment ces huit années en les racontant, elle réagit aussi fort qu’à l’instant où les choses se passent. Par exemple, une nuit, l’écrivain l’envoie en mission (porter un message ou un livre, je ne sais plus). Quand elle revient auprès de son maître pour en rendre compte, elle lui avoue avoir donné cinq francs « à un sergent de ville » qui l'a guidée dans l'obscurité jusqu'à la bonne adresse (« un escalier bossu »). Proust part alors d'un grand éclat de rire, et elle, racontant la scène, éclate du même rire cinquante ans après : « Et il riait ! Il riait ! ». C’est cette absolue spontanéité-sincérité rétrospective qui m’a poussé à lire ce livre acheté en 2002. Je ne l'ai pas regretté.
L’image de Marcel Proust qui ressort du tableau peint par Céleste Albaret au cours de quarante (ou soixante-dix) heures d’entretien avec Georges Belmont est assez différente de celle que l’histoire littéraire en a construite. En particulier dans tout ce qui concerne sa vie quotidienne au cours de ses dernières années. D’abord la maladie : c’est comme malade qu’il a demandé à Céleste de le considérer et de le servir. On ne peut en effet pas dire que Proust jouissait d'une grande santé : contre son asthme, il pratiquait des fumigations, respirant les fumées d'une poudre qu'il enflammait et fuyant toutes les occasions de subir des crises très éprouvantes.
Après l'avoir suivi dans son dernier séjour à Cabourg, en 1914, au retour duquel (au niveau de Mézidon) il a une crise particulièrement violente, elle l'accompagne dans son choix définitif de vie recluse : il ne quittera plus guère sa chambre aux rideaux toujours fermés et aux murs revêtus de plaques de liège. A la lecture de ses souvenirs, je me suis souvent dit que Proust était un insupportable maniaque doublé d'un enfant capricieux, avec sa phobie des poussières, avec son « essence de café » que Céleste apprendra très vite à préparer méticuleusement, avec sa pile de mouchoirs sur sa table, mouchoirs qu'il jetait par terre après le premier usage, etc.

La chambre de Marcel, reconstituée. Noter la petite table avec sa pile de mouchoirs.
Pour Céleste Albaret, qui est tout sauf une universitaire ou une critique littéraire, pendant les huit années où elle a vécu auprès de Marcel Proust, celui-ci était guidé par une seule idée : achever la "Recherche". C'en est au point qu'à ses yeux, toutes ses sorties dans des soirées mondaines, tous ses soupers fins au Ritz, chez Larue ou ailleurs, toutes les visites qu'il rendait ou recevait, toutes ses pensées, tous ses gestes n'avaient qu'un seul et unique objectif : achever la "Recherche". Elle n'en démord jamais. Hors de toute considération universitaire, j'aime à penser qu'elle n'a peut-être pas tort.
Elle était seule présente, en compagnie du Dr Robert Proust, frère de Marcel, à l'instant où ce dernier mourut.
Une belle personne à coup sûr, Céleste Albaret.
Voilà ce que je dis, moi.
***
Et un matin (en fait, il est quatre heures l’après-midi), pages 402-403 : « Comme j’arrivais près du lit, il a tourné un peu la tête vers moi, ses lèvres se sont ouvertes et il a parlé. Depuis que je vivais auprès de lui, c’était la première fois qu’il m’adressait la parole au sortir de son réveil et avant d’avoir pris sa première tasse de café. Jusqu’à sa mort, cela ne s’est plus reproduit. J’ai été surprise malgré moi, et je suis restée là, en suspens. Il m’a dit :
- Bonjour, Céleste …
Un petit instant, son sourire a paru déguster ma surprise. Puis il a repris :
- Vous savez, il est arrivé une grande chose, cette nuit …
- Que s’est-il passé, Monsieur ?
- Devinez.
Il s’amusait beaucoup. Rapidement, dans ma tête, j’ai fait le tour de ce qui aurait pu arriver. Ce ne pouvait pas être une visite inattendue – je l’aurais su et entendu ; jamais il ne fût allé ouvrir lui-même la porte. Qu’il ait pu se relever pour sortir était également inconcevable ; jamais il n’eût décroché de ses mains son pardessus et son chapeau dans le vestiaire ; toujours il fallait que tout fût préparé. Tout en cherchant, j’inspectais du regard la chambre. Je me disais : "personne n’est venu ; il n’a pas demandé ses vêtements ; il n’est pas sorti ; il n’a pas grillé sa bouilloire électrique ; il n’a rien cassé ; tout est en place …"
J’ai dit :
- Monsieur, je ne vois pas du tout ce que cela peut être, je ne peux pas deviner. Cela doit être un miracle. Il faut que vous me l’appreniez.
L’air tout heureux et rajeuni, il jubilait comme un enfant qui a joué un bon tour.
- Eh bien, ma chère Céleste, je vais vous le dire. C’est une grande nouvelle. Cette nuit, j’ai mis le mot "fin".
Il a ajouté, toujours avec son sourire et cette lumière dans son regard :
- Maintenant, je peux mourir.
J’entends sa voix prononçant ces derniers mots : on aurait cru une explosion de satisfaction et de joie. »
Je plains l'universitaire sérieux qui tombe sur cette expression : "déguster ma surprise" !!! Est-ce que ça ne vaut pas le coup, vraiment, d'avoir vécu ce moment-là ?
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, marcel proust, la recherche du temps perdu, céleste albaret, georges belmont, céleste albaret monsieur proust, france culture, philippe garbit france culture, france culture la grande traversée, 102 boulevard haussmann, auxillac lozère
mercredi, 25 septembre 2019
LA MÉTHODE VIALATTE
J’avais osé intituler ici « la méthode Vialatte », au mois d’août 2012, un long, trop long délire (réparti sur cinq jours, s'il vous plaît), en digressant interminablement, en circumnaviguant pesamment, en un mot : en tournant longuement autour du pot, autant dire que j'étais tombé dedans pour ne plus en sortir. Inutile d’ajouter que la densité de matière solide à la sortie du tuyau tendait vers zéro : c’était du pipi de chat, du jus de chaussette, résumons-nous : c’était de la pisse d’âne.

Non, je ne dirai pas de qui est ce fragment de gravure sur bois.
J'espère avoir fait quelques progrès depuis ces temps cornus, spiraloïdes et macroglosses, quand, semblable à un œuf, une citrouille ou un fulgurant météore, ce blog roulait sur cette terre, où il faisait ce qu'il lui plaisait.
 Mais il se trouve que, au cours de mes révisions estivales des Chroniques de La Montagne, qui me ravissent dès que j’ouvre n’importe lequel des treize volumes Julliard, je suis tombé, à la page 155 de Et c’est ainsi qu’Allah est grand (Julliard, 1979), sur un article qui expose benoîtement la méthode que je cherchais méticuleusement naguère à obscurcir de la fumée cotonneuse d’un galimatias directement traduit du volapük. Et ce, alors même que je m'étais promis d'expliquer comment s'y prenait Alexandre Vialatte pour frapper l'attention et marquer la mémoire du lecteur de façon si particulière. Je m’empresse donc de laisser la parole à quelqu'un qui est, pour le coup, un auteur.
Mais il se trouve que, au cours de mes révisions estivales des Chroniques de La Montagne, qui me ravissent dès que j’ouvre n’importe lequel des treize volumes Julliard, je suis tombé, à la page 155 de Et c’est ainsi qu’Allah est grand (Julliard, 1979), sur un article qui expose benoîtement la méthode que je cherchais méticuleusement naguère à obscurcir de la fumée cotonneuse d’un galimatias directement traduit du volapük. Et ce, alors même que je m'étais promis d'expliquer comment s'y prenait Alexandre Vialatte pour frapper l'attention et marquer la mémoire du lecteur de façon si particulière. Je m’empresse donc de laisser la parole à quelqu'un qui est, pour le coup, un auteur.
« "J’ai oublié mon écureuil chez le brocanteur", dit le gros commissaire [désolé, monsieur Vialatte, Béru est avant tout inspecteur principal, excusez-moi de vous avoir interrompu] Bérurier dans un roman de San Antonio. Cette phrase, détachée de son contexte, prend des proportions étonnantes. Placée par l’isolement dans l’optique du fragment, de la maxime, du paradigme, du précepte, bref du proverbe intraduisible, elle s’enrichit de mystère et de folles résonances, comme ces statues qu’on sort du fond de la mer, plus belles d’avoir été tronquées. Elle a l’air de traduire on ne sait quelle situation ou quelle vérité générale, universellement applicable, elle prend l’importance d’un passe-partout. Elle peut même faire un détecteur de vérités.
Qui de nous, en effet, à bien regarder les choses, n’a "oublié son écureuil chez le brocanteur", sa dignité chez le marchand de vin, son parapluie dans le couloir du métro, son cœur à Heidelberg (c’est une chanson allemande), son chagrin dans le whisky ou son âme dans le ruisseau ? Cet "écureuil" est universel, on peut lui faire symboliser toute chose, il aura toujours son "brocanteur", qu’on peut remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. Cette méthode peut fournir un volume de proverbes, une sagesse, une philosophie et même plusieurs poèmes lyriques. On voit par là que tout est dans tout.
Et même réciproquement disait un philosophe. (Et il y aurait témérité à le contredire.) Il en résulte qu’on peut prendre la vérité, ou tout autre chose, par n’importe où, et tout suivra ; il n’y a qu’à tirer un peu sec, ou adroitement, sur le bout de la laine, tout l’écheveau, ou le nœud, y passera. (C’est ce que font les psychanalystes.) Si vous avez à parler d’un sujet, commencez donc par n’importe où. Voilà qui facilite les choses. Beaucoup de gens, qui sont pleins d’idées, ne savent jamais par où commencer. Commencez par n’importe quoi, le Soleil, la machine Singer, que sais-je, le président Fallières. Au besoin, vous pouvez même toujours vous servir du même commencement ; par exemple : "Le Soleil date de la plus haute antiquité." Si vous dites la même chose du président Fallières, ajoutez vite : "Il existait bien avant moi." Parti de prémisses si fermes et si catégoriques, pour arriver au sujet même (disons le tigre du Bengale, la femme fatale ou la pomme de Newton), vous serez obligé de l’extérieur à faire de tels rétablissements de l’esprit et de l’imagination que vous trouverez en route mille idées à la fois plaisantes et instructives qui ne vous seraient jamais venues sans cela. Je ne vends pas la recette, je la donne. Cette contrainte extérieure, qui est comme celle de la rime, vous aidera, loin de vous entraver. C’est la nécessité de la rime qui a fait naître les plus beaux vers. C’est l’élan que vous donne la barre fixe qui vous fera faire le saut du lion. Si le jarret la coince bien (il ne faut pas la lâcher ! du moins avant d’avoir la hauteur nécessaire). Cramponnez-vous bien aux prémisses, ne lâchez pas le président Fallières (ou le Soleil, ou la machine à coudre), avant de sentir que vous n’en avez plus besoin, visez bien le terrain d’arrivée (femme fatale ou pomme de Newton) et vous retomberez sur vos pieds après une courbe des plus belles, imposée de l’extérieur par les lois de la pesanteur.
Pour la conclusion, même principe : concluez sur n’importe quoi. Qui aura été fixé d’avance. Voyez les sermons du grand siècle. Ils finissaient toujours sur un Ave Maria, quel qu’en eût été le développement. C’était la "chute à l’Ave Maria" ; et on jugeait le prédicateur sur la souplesse de l’éloquence avec laquelle il amenait sa prière. Le naturel naît de la contrainte. Le naturel n’est pas naturel. C’est la grande leçon de La Fontaine. L’aisance s’ajoute. On n’arrache pas "naturellement" deux cents kilos sans faire une tête de crapaud qui fume ; c’est par l’artifice du travail qu’on parvient à le faire en souplesse. Le naturel est artificiel. »
L’article se poursuit, mais dérive quelque peu, sans doute pour se conformer au principe énoncé ci-dessus en l’illustrant. On a compris l’essentiel : n’importe quoi au début, n’importe quoi à la fin et, entre les deux, ce que vous voulez. Je soupçonne fort, d'ailleurs, Alexandre Vialatte d’avoir très souvent appliqué la méthode ainsi détaillée (« la recette ») dans la conduite de ses chroniques. Parent du Bolbina d’Henri Bosco, il y a du jongleur chez Alexandre Vialatte : il lance dans l’air une foule de boules, d'étoiles et de bulles de savon lumineuses qu'il est bien forcé de rattraper quand elles retombent, qu'il fait remonter d'une impulsion vers le ciel, et qui dessinent la spirale d'une galaxie dont il est le noyau invisible et le créateur habile (ça, c'est bien senti, non ?). On voit que ça mousse, on se demande comment ça se fait, mais il n’y a rien, et c’est magique. Ou plutôt, c'est de la prestidigitation.
"Rétablissements de l'esprit et de l'imagination" : en partant à l'aventure, en créant sous votre plume l'inconnu que vous redoutez et qui vous est nécessaire, vous créez objectivement une contrainte "extérieure" (sans doute inspirée de la règle d'un jeu surréaliste des origines ou des amusements oulipiens de Queneau et Le Lionnais) qui vous oblige à inventer le lien entre cet "alien" et le sujet que vous vous êtes proposé. C'est de l'ordre du geste, c'est de la gymnastique, voire de l'acrobatie (j'aime beaucoup les "deux cents kilos" qui annoncent la "tête de crapaud qui fume"). Disons-le : c'est du style !
Voilà ce que je dis, moi.
Note : l’intégrale des Chroniques de La Montagne (Robert Laffont, coll. Bouquins, an 2000) nous apprend que cet article est paru dans le journal auvergnat le 17 décembre 1967.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, éditions julliard, henri bosco bolbina, collection bouquins, la méthode vialatte, littérature française
jeudi, 01 août 2019
VIALATTE ET LES VACANCES
L'évadé rattrapé et l'évadé perpétuel.¹
Je n’hésite pas à la [la recette] répéter. Il faut passer des vacances de pluie dans des endroits humides et noirs, au bord d’un canal latéral (les canaux latéraux ont leur vertu magique), par exemple dans quelque cave d’un faubourg de banlieue minière, en inventant des jeux simples et monotones qui puissent se jouer avec la houille ou l’anthracite, et sur le soir (je parle pour les dames) tricoter, comme font les Bretonnes, sous un parapluie, sur le seuil, quelque pull-over de laine noire pour les orphelins d’un homme-tronc. Rien n’empêche non plus, entre-temps, de regarder, par le soupirail, tomber l’averse ou passer à pas lents le cheval du corbillard dont l’écurie est proche, entre l’écluse où se suicident les comptables, et le terrain vague où l’usine voisine empile ses autos écrasées.
Et pourquoi ne peut-on donner une recette plus belle et plus simple ? D’abord parce qu’elle est peu coûteuse ; on trouve généralement dans les banlieues minières des caves à très bas prix ; ou alors des celliers ; voire des cages à lapins de peu de valeur commerciale ; mais ensuite et surtout parce qu’elle répond au vœu le plus profond de la nature humaine. De quoi l’homme rêve-t-il ? D’évasion. Le bureau lui pèse et l’usine le tourmente, le H.L.M. le rend neurasthénique, le va-et-vient dans le métro lui donne le mal de mer. Il veut changer, il désire autre chose, il aspire à des horizons ; des cocotiers, des plages, que sais-je, des archipels polynésiens. Des femmes sauvages qui nagent avec des colliers de fleurs. Il ne les a pas depuis un mois, parfois quinze jours, qu’il doit rentrer. Il retrouve son usine, son bureau, ses dossiers, son porte-parapluie bleu ciel, sa plante verte, ses charentaises, il est complètement écœuré. Les vacances furent un rêve, le travail lui est une prison. C’est un évadé rattrapé. Au lieu que le sage qui a pris sagement des vacances de pluie dans les conditions que je conseille, sort de sa cave avec une frénésie de travail, il ne pense qu’à retrouver le décor de sa vie, il rêve de la réalité comme d’une espèce de conte de fées, l’usine lui semble un paradis, il prend le concierge pour saint Pierre et le chef de bureau pour le bon Dieu. Ce n’est pas, comme l’autre, un évadé de quelques semaines, c’est un évadé perpétuel. Il vit dans la vie comme dans un songe.
¹Note : le titre du texte n'est pas d'Alexandre Vialatte.
***
Je ne sais pas vous, mais moi, je suis renversé par "tricoter, comme font les Bretonnes, sous un parapluie, sur le seuil, quelque pull-over de laine noire pour les orphelins d'un homme-tronc".
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, alexandre vialatteles champignons du détroit de behring, vacances
lundi, 22 juillet 2019
VIALATTE ET LES JOURNALISTES
L'été est propice à la révision des Chroniques d'Alexandre Vialatte.
J’ai dit hier combien je suis horripilé par le choix des « sujets » qui remplissent trop souvent les bulletins d’information, journaux écrits, radiophoniques ou télévisés. Il semblerait qu’Alexandre Vialatte n’éprouve qu’une estime modérée pour la profession même de journaliste, cette sorte de chien de chasse toujours la truffe au vent qui court après l’événement. Il y a quelque chose de désespérément futile et de futilement désespéré dans cette recherche inlassable et jamais aboutie de la réponse à la vaste question que se pose, taraudé par le doute, l’homme qui s’ennuie : « Qu’est-ce qui se passe ? ». Si sa vie était pleine, il se contenterait d'exister.
Le problème essentiel du journaliste est précisément qu’il se passe quelque chose à tout moment et en tout lieu. Cela n’aide pas l’esprit humain à se faire une idée bien nette du sens de la vie. Le journaliste, en désespoir de cause et poussé par son rédac’chef, se rabat en général sur ce qu’il suppose devoir intéresser le lecteur. Eh oui, il faut vendre. Il faut bien vivre.
Trop souvent hélas, il s’imagine que ce qui intéresse le lecteur, c’est le lecteur lui-même. Il s’ensuit que le journaliste ordinaire finit par lui tendre non les clés de compréhension du monde qui l’entoure, mais une sorte de miroir. On appelle ça "répondre à la demande", "se mettre à la portée". La "loi du marché", quoi. Ce faisant, la presse d'information oublie que son vrai lecteur ne veut surtout pas qu'on lui serve un produit dont les caractéristiques ont été déterminées par de savantes enquêtes marketing : il attend des éléments de connaissance précis. C'est dire qu'en termes d'altitude, le niveau général de la presse d'information se rapproche du niveau de la mer (certains répondront avec raison qu'il s'en passe aussi de belles, au niveau de la mer !).
La prose d'Alexandre Vialatte, au contraire, s'élève vers les sommets : il ne saurait s'abaisser à dire que, pour lui, l'activité de l'homme, qui motive et induit la trajectoire du journaliste, est étonnante de petitesse. Vialatte possède au plus haut point l'art de laisser deviner (sans que jamais ce soit formulé), par la seule énumération d'éléments juxtaposés, ce qu'il convient de penser de l'ensemble. Jugement d'une grande justesse, irréprochable courtoisie, cette élégance, cette subtilité s'appelle littérature.
Pauvres journalistes, finalement.
***
La presse indiscrète.
L’homme s’est, de tout temps, intéressé à l’homme. A ce qu’il dit, à ce qu’il fait, à ce qu’il voudrait qu’il fasse. Il lui écrit des lettres anonymes, il le traîne en justice. Il « este » contre lui, comme disent les mots croisés. Il lui déclare des guerres mondiales, il le pend, il le brûle, il veut savoir ce qu’il fait, ce que mijote le voisin, ce qu’en a dit sa belle-sœur, pourquoi le mariage s’est fait, pourquoi il ne s’est pas fait, où le sous-préfet est allé en vacances, et pourquoi la chaisière a mis un chapeau neuf. Toutes ces choses le passionnent. Il cherche à les savoir. Telle est l’origine de la presse. Elle lui raconte l’homme tous les matins, les dictateurs barbus, les Chinois en colère, les gens qui ont été brûlés vifs, la lune de miel du garçon-coiffeur qui a épousé la grande chanteuse, et ce qu’a dit M. Marcel Achard en distribuant les prix de vertu. Il y prend un plaisir extrême. Il apprend en même temps le temps qu’il a fait la veille, la meilleure marque de chaussettes, comment on peut gagner du temps en faisant sa lessive la nuit, et « Ce que j’ai fait de plus scandaleux » par la vedette du film à la mode. Tous ces renseignements lui bourdonnent dans la tête. Il sait comment le coureur Robic ouvre le robinet de sa baignoire, se savonne, se rince et s’essuie, et qu’au sommet de la fameuse côte qui décidait de la énième étape, Antonin Magne a dit très nettement : « Il fait chaud ». Il est frappé par la justesse d’un tel propos. Il le rapporte à son chef de bureau. Il s’émerveille de voir les grands hommes aussi simples. Il vit à l’échelle planétaire une vie multipliée par tous les événements.
***
Ces événements, qui les raconte ? Le journaliste. Qui distribue tous les matins à l’homme à jeun ce pain de l’événement nécessaire à sa faim ? Le reporter, l’envoyé spécial. Car l’homme ne vit pas seulement de pain au sens où l’entend le boulanger, mais aussi du récit des événements de la veille. Et c’est pourquoi le monde est couvert de journalistes qui vont et viennent dans tous les sens, les uns à bicyclette, les autres en avion, d’autres encore à motocyclette ou dans les rapides automobiles qui volent à la vitesse du vent ; certains même en hélicoptère. Ils empruntent les téléphériques, les autostrades et les routes nationales. On les trouve sur les cimes et les chemins vicinaux, les sentiers de chèvres et les pistes routières, à des hauteurs vertigineuses, parfois aussi, comme en Hollande, bien au-dessous du niveau de la mer. Ils montent sans peur dans les ballons sphériques. Pendus au bout d’un parachute, ils filment les parachutistes ; lancés à ski sur une pente redoutable, ils filment les champions du ski. On les trouve dans les sous-marins, dans les brousses des coupeurs de tête et dans l’igloo de l’Eskimo canadien. Le thermomètre est descendu à moins 60 ? Ils n’en ont cure ; ils glissent vivement sous leur chemise un vieux numéro de Paris-Soir pour se protéger la poitrine et continuent à photographier le chasseur de phoque, le chien de traîneau, le veau marin et l’Evêque du vent. Pour avoir le genou plus à l’aise, ils portent une culotte de golf et mettent un costume à carreaux. Ils se cachent dans une valise en fibre végétale pour filmer les grands événements.
C’est ainsi qu’ils peuvent satisfaire les exigences de la curiosité des hommes. (Car l’homme a commencé par la curiosité, qui le fit chasser du Paradis terrestre, et ne se survit, dans son grand âge, que grâce à elle. C’est son premier et dernier péché.)
 ***
*** 

On aurait tort de croire que tous les journalistes portent un veston à carreaux. D’autres s’habillent comme Fantômas, avec une cape et un haut-de-forme, pour assister à la première de toutes les pièces dans des théâtres illuminés. Ensuite, cachés dans les coulisses, ils surprennent les secrets des acteurs. Le lendemain matin, dans leurs chroniques, ils font la gloire des dramaturges et racontent les plus beaux divorces, et même quand ce n’est pas vrai c’est rudement bien inventé, et les actrices sont très contentes. D’autres encore se dissimulent à la Chambre des députés pour révéler les dessous de la politique mondiale et d’autres au Palais de justice pour pouvoir raconter les meurtres les plus drôles. D’autres encore composent des mots croisés, des logogriphes et des charades pour charmer les loisirs de l’homme. D’autres enfin organisent des concours où le lecteur peut gagner un superbe lapin. Aussi la presse a-t-elle toutes les faveurs de l’homme. Elle lui est devenue indispensable. Le journaliste est l’homme de l’avenir.
Il est aussi l’homme d’un long passé au cours duquel il n’a cessé de se répandre en habiles reparties, et même saillies ingénieuses. Jean-Paul Lacroix a réuni trois cents pages de ces mots d’esprit.
Ils sont tous meilleurs les uns que les autres.
Et c’est ainsi qu’Allah est grand.
La Montagne, 25 février 1968.
Chronique choisie par Ferny Besson, figurant dans Profitons de l'ornithorynque, Julliard, 1991.
***
Note : je ne ferai pas l'injure au lecteur d'indiquer d'où sortent les quelques vignettes qui servent d'illustration à ce billet.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, chroniques de la montagne vialatte, profitons de l'ornithorynque, littérature, littérature française, journalistes, prersse, jounaux, journal le monde, journal le figaro, journal libération, rédac'chef, société
samedi, 20 juillet 2019
VIALATTE ET LA CHALEUR
Parcourant, en façon de révision estivale, les chroniques d'Alexandre Vialatte compilées par sa grande amie Ferny Besson et publiées par la maison Julliard (treize volumes, je crois), il m'arrive de tomber, une fois de plus ébahi (mais c'est toujours une fois de plus et toujours ébahi), sur quelque aperçu saisissant de bon sens et de vérité, à propos de quelque curiosité littéraire ou esthétique, condensé dans une formule définitive.
Cette fois, c’est dans Pas de H pour Natalie (Julliard, 1995) que j’ai trouvé la pépite. A propos de Céline, ce pestiféré. Il est en train de parler des grands maîtres en littérature. Qui sont marqués d’une propriété étonnante : ils sont « réconfortants », ils offrent un « schnaps aux autres hommes », il y a, dans leur écriture « quelque chose de roboratif ».
Attention : « Ce réconfort peut se trouver dans le plus noir pessimisme s’il est inspiré par autre chose qu’une mécanique à fabriquer des mots. Quoi de plus décourageant, objectivement, que Céline ? Quoi de plus amer que sa vision des hommes ? Quoi de plus malodorant que ses châteaux de bouse de vache qui se reflètent dans un flot de purin ? Mais ils sont si monumentaux, il a fallu pour les bâtir tant d’enthousiasme, de verve, de génie créateur, qu’il emporte l’admiration, le rire, le déchaînement lyrique ».
Et c’est là que je fais mon pointer de pure race, vous savez, ce chasseur qui, quand il renifle le faisan blotti dans le buisson, s'immobilise de façon si soudaine qu'il semble changé en statue de pierre : je marque l'arrêt, pile en sursaut : « D’autant plus qu’une telle amertume ne peut être le fait que d’une égale déception, et pour être tellement déçu il faut s’être fait des hommes une idée bien grandiose. Il faut les avoir trop aimés. »
Là je dis : admirable de justesse. A peine quelques mots, et voilà Céline tout entier, avec sa littérature du dépit amoureux, de la rage du déçu qui ne cesse d’injurier son idéal, parce qu’il lui en veut à mort de n'avoir pas tenu ses promesses, pire : de s'être désintégré sous ses yeux, laissant l'adolescent exalté devant le cadavre puant du paradis promis. Une leçon d'analyse littéraire : au cœur du sujet, sans contorsions cérébrales.
Et Vialatte élargit son propos : « Résumons-nous : si, comme le disait Gide, ce ne sont pas les bons sentiments qui font la bonne littérature, c'est tout de même, de façon ou d'autre, le cœur qui passionne le débat. Il faut que le lecteur sente derrière le talent je ne sais quelle épaisseur ou quelle chaleur humaine, quelle vitalité contagieuse, quel "amour" disait Goethe (j'aimerais dire "allégresse").
Il y a des œuvres et des auteurs, qu'on touche comme des serpents ou comme des mécaniques ; ils refroidissent la main comme le fer ou le boa. Je crois que les grands auteurs sont les grands mammifères : ils ont le sang chaud, le poil fourni, la robe luisante. Touchez-les en hiver, la main revient réchauffée.
Pourquoi tant d’œuvres passent-elles si vite malgré le vernis du badigeon, ou même le papier à fleurettes, malgré le talent pour employer le mot qui convient ? C'est qu'il est tendu sur du vide, sur un lattis, ou sur un mur lépreux. On ne sent pas, sous cette pellicule, le frémissement du cuir, la chaleur animale. Si vous tapez dessus, le papier crève. Au contraire, attrapez Dickens, Rabelais, Saint-Simon ou Montaigne ; frappez fortement sur la croupe, et c'est comme un grand cheval qui se met à marcher ; la vapeur lui sort des naseaux, son pas égal et fort fait résonner le village ; montez dessus et vous irez loin. »
Alexandre Vialatte évoque ensuite, pour illustrer son espèce de théorie littéraire (Vialatte n'a pas de théorie littéraire, mais une attitude morale, en fin de compte), la personne de Marie-Aimée Méraville, qui vient d'être enterrée à Condat : « Courageuse, modeste, auvergnate », femme obscure et bel écrivain qui a enseigné toute sa vie à Saint-Flour, pour qui il éprouve de l'admiration, pour la raison même qu'il vient de développer. « Je ne sais, mais la plupart des morts tendent aux vivants, du fond de la tombe, une main glacée. Méraville leur tend une main chaude. » Le vrai lecteur est une caméra thermique.
On n'arrive pas à définir ce qui donne à une œuvre l'animation de l'existence palpitante. Mais quand on est en présence, on le sait, point, c'est tout. Mine de rien, en quelques mots, Alexandre Vialatte vient de répondre à la vieille question : « Qu'est-ce que la littérature ? – C'est la chaleur animale. »
***
"Considérations sur la tombe de Marie-Aimée Méraville" est paru dans La Montagne le 24 septembre 1963.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, littérature française, pas de h pour natalie, marie-aimée méraville, dickens, rabelais, saint-simon, montaigne, louis-ferdinand céline, ferny besson, éditions julliard
mercredi, 19 juin 2019
ROMAIN GARY : CHARGE D'ÂME
 Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.
Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.
Marc Mathieu est la quintessence du physicien d’envergure einsteinienne, et il est reconnu comme tel par ses pairs : il passe son temps à chercher, et il trouve tellement qu’il constitue à lui tout seul la pointe avancée de toute la physique mondiale, l’explorateur ultime des confins du possible. Toute l’équipe du laboratoire où il travaille (le Cercle Erasme) est guidée par le « mot d’ordre » de Mao Tsé Toung : « L’énergie spirituelle doit être transformée en énergie matérielle » (p.39).
Marc Mathieu, ainsi que ses collaborateurs, prend cette phrase au pied de la lettre. Et bien que le savant ait un peu de mépris pour son collègue Chavez ("profiteur, exploiteur, applicateur" et un peu épais), c'est bien lui, Mathieu, malgré qu'il en ait, qui fera de ses recherches une réalité concrète, sur la base de : « ce qui peut être réalisé doit être réalisé » (p.133), où l'on reconnaît la philosophie intraitable de Günther Anders dans L'Obsolescence de l'homme. Déjà, page 60 : « On pouvait, à présent, et donc on devait aller plus loin » (Günther Anders : « –, on considère ce qui est possible comme absolument obligatoire, ce qui peut être fait comme devant absolument être fait », Editions Fario, p.17). La recherche fondamentale, la recherche pure ne travaille pas dans des abstractions définitives, et débouche toujours sur le monde réel, pour le meilleur et pour le pire. Jamais, dans toute l'histoire humaine, une grande découverte n'a été utilisée seulement pour le Bien : Satan est le complément nécessaire de Dieu.
Ici, il s’agit très concrètement de récupérer le souffle (« l’âme ») des gens au moment où ils meurent pour en faire le carburant révolutionnaire (« carburant avancé ») des moteurs et des machines. C’est d’ailleurs ce qui arrive à Albert, le chauffeur du laboratoire qui, en mourant, vient alimenter, grâce à un dispositif spécial, le moteur de la voiture de fonction. Le pauvre Albert le fait d’abord à contrecœur (le moteur hoquette), puis il s’y fait, et le moteur tourne rond. Malheureusement, le dispositif n'est en mesure de capter les "âmes" que dans un rayon de soixante-quinze mètres.
Marc Mathieu est français, quoique guère patriote : tout le fruit de ses découvertes, il le transmet aussitôt aux Américains et aux Russes, alors en pleine guerre froide. Toutes sortes de services secrets gravitent autour de lui en permanence, à l’affût de la moindre velléité de choisir un camp plutôt qu’un autre. Certains de ses collègues ne l'aiment pas, tel le cynique Kaplan : « C'est le genre de démagogue qui passe son temps à protester contre les conséquences de ses propres découvertes » (p.236).
Mais un collègue de Mathieu était porteur de la même idée : « Valenti, quant à lui, se laissait aller à un désespoir lyrique et passait ses journées, comme la plupart des savants, à signer des manifestes de protestation contre les conséquences pratiques de ses propres découvertes » (p.91). Message adressé à l'hypocrisie des optimistes qui pensent, contre toute raison, que "la technique est neutre, tout dépend de l'utilisation qui en est faite". Je pense au mot de Bossuet : « Dieu méprise les hommes qui méprisent les effets dont ils chérissent les causes ».
Marc Mathieu vit en compagnie d’une femme, May, qui le comble physiquement, précisément parce que, pense-t-il, elle est restée une créature primitive, presque animale, incapable d’accéder aux sphères intellectuelles les plus subtiles, où il se meut quant à lui, avec aisance : « Mathieu s’était dit mille fois que s’il trouvait un jour une femme incapable de le comprendre, ils pourraient être vraiment heureux ensemble. Le bonheur à deux exige une qualité très rare d’ignorance, d’incompréhension réciproque, pour que l’image merveilleuse que chacun avait inventée de l’autre demeure intacte, comme aux premiers instants » (p.62). Sans même évoquer l’idée de l’amour, Gary en fournit une condition éblouissante, qui fait penser, quoique sur une tout autre toile de fond, aux relations entre les sexes dans l’univers houellebecquien.
Au début de l’action, Marc Mathieu est sur la piste d’une énergie totalement nouvelle, de loin plus puissante et infiniment moins coûteuse que l’énergie nucléaire, dont il pressent qu’elle pourrait fournir l’arme absolue, une arme aux dimensions et aux effets quasi-divins, en même temps qu’une source d’énergie quasi-gratuite : l’âme des hommes.
Pour le moment, il bute sur une difficulté qui empêche de rendre la chose opérante : « Sur le tableau noir, les formules couraient dans tous les sens, mais c’était de l’art pour l’art, une pure jouissance esthétique. Elles ne menaient nulle part, n’ouvraient aucun chemin dans les terres vierges. Le souffle demeurait invisible. Le "craquage", c’est-à-dire la désintégration contrôlée indispensable à l’exploitation rationnelle, continuait à se dérober. La maudite unité refusait de se soumettre. Une sorte d’irréductibilité première, absolue. Il manquait une idée » (p.112).
Aussitôt que May, par peur ou scrupule, a rendu visite à l’ambassade américaine pour tenir les « alliés » au courant des dernières avancées, le colonel Starr est dépêché auprès du savant pour le sonder, le « conseiller », et s’il le faut, mais à la toute dernière extrémité, le tuer. Starr est un excellent espion, mais il est aussi et d’abord un tueur. Il arrivera à May, à l’occasion, d’aller voir aussi les Russes. On voit que les relations entre la femme et le savant ne sont pas évidentes, mais Marc Mathieu, tout entier absorbé dans la quête de son Graal, est bien au-delà des basses contingences terrestres.
Mais un jour, le colonel Starr vient le voir pour l’avertir que, s’il ne choisit pas à l’instant « le bon camp » (on devine lequel), il prend le risque d’être liquidé : son cerveau est devenu une menace pour l’équilibre mondial. Lui et ses supérieurs en sont convaincus : « Vous êtes parvenu à désintégrer le souffle, professeur ».
Il l’invite donc à continuer ses recherches en Californie, un avion est là qui attend. Le savant ose lui répondre : « A propos, pour votre information personnelle, colonel, j’ai fait mieux que désintégrer l’élément. "J’ai fait un pas au-delà" ». Après cette déclaration énigmatique et menaçante, Marc Mathieu et May disparaissent de la circulation, après avoir échappé à l’explosion d’une bombe, quelque part en Italie (le savant éloigne aussitôt la voiture, de crainte que l'âme de May soit "absorbée"). Où peuvent-ils bien avoir trouvé refuge, se demandent Américains et Russes ?
Leurs satellites-espions ne tardent pas à repérer l’étrange construction et la rapide extension d’une installation industrielle quelque part au nord de Tirana, dans « la vallée des Aigles ». Marc Mathieu a donc offert ses services à Imir Djuma, le terrible dictateur qui règne sur l’Albanie, qui a bien entendu accueilli le savant à bras ouverts. Mathieu a fait ce choix parce que la société albanaise est militarisée, disciplinée et formatée de la façon la plus pure, et que cette pureté est une condition expresse de la réussite de l’entreprise.
Ça n'empêche pas le savant de croiser le Christ, dans une scène de pure loufoquerie (« Evidemment que je vous connais. Avec vous et les autres ... Comment déjà ? Oppenheimer, Fermi, Niels Bohr, Sakharov, Teller ... Avec vous, c'est devenu scientifique. – Quoi ? Qu'est-ce qui est devenu scientifique ? – La Crucifixion. » (p.224-225). Mine de rien, Romain Gary lance une belle charge contre la science. Dans La Fête de l'insignifiance (Gallimard 2014), Milan Kundera place, me semble-t-il, une scène aussi loufoque sous une statue du jardin du Luxembourg, avec l'apparition de Staline et consort.
Ici se met en place un jeu qui relève à la fois de la farce et de la géopolitique. L’auteur trouve le ton qu’il fallait pour nourrir l’échange des dirigeants les plus puissants de la planète (USA, URSS, Chine) : il y a de quoi rire. Mais eux ne rigolent pas : ils décident de mettre en place un commando multinational qui devra, grâce à une machine spéciale à transporter sur place, réduire à néant la menace de disparition totale que fait peser sur la population mondiale la mise en route des installations albanaises.
L’usine a commencé à fonctionner. Les Albanais ont construit à proximité toute une série d’asiles où le pays rassemble tous les vieillards, pour que leur mort ne soit pas inutile à la nation, mais vienne alimenter l’usine en énergie : à l’instant fatidique, un collecteur judicieusement placé transmet l’âme du défunt à l’accumulateur central.
Le récit de l’opération de commando proprement dite est digne du film d’action, mais une fois le but atteint, il part un peu dans tous les sens, et le passage de la frontière avec la Yougoslavie donne tant soit peu dans le baroque. May et Marc Mathieu y trouvent la mort, pour le plus grand bienfait du moteur qui se remet en marche pour mener les survivants en lieu sûr.
Au total, un livre qui se lit avec grand plaisir, mais à coup sûr pas le meilleur de Romain Gary. Peut-être l'argument est-il trop tiré par les cheveux. Prenons-le pour une fable, mais qui n’arrive pas à se prendre assez constamment au sérieux. L'idée centrale tourne autour de l’hybris humaine, cette folie qui consiste à vouloir toujours repousser les limites, au mépris même de toute raison : « Le génie scientifique sonnait le glas de la démocratie, parce que seul le génie pouvait contrôler le génie. Et cela voulait dire que les peuples étaient à la merci d'une élite » (p.264).
La déraison humaine est correctement synthétisée dans cette formule qu’on trouve à la toute fin de la première partie : « Si jamais le monde est détruit, ce sera par un créateur » (p.143). Là, Gary pense peut-être à la bombe H. Charge d'âme est précisément une charge, moins contre la science en elle-même (quoique ...) que contre la sacralité dont la modernité habille la recherche scientifique, et contre les dégâts que son usage inconsidéré risque de commettre : « En quelques minutes, toute la litanie écologique se déversa sur ses lèvres. L'empoisonnement chimique des fleuves, mers et océans, la destruction de la faune, la mort des grandes forêts, des sources d'oxygène, l'élévation de la température du globe par suite de l'activité industrielle, qui menaçait la vie sur terre ...» (p.123). On est en 1977 !!! Franchement, y a-t-il quelque chose à enlever ou à corriger ? Romain Gary, écologiste visionnaire !
Car le message est limpide, quelque chose comme "l’humanité, à force d’outrepasser son humble mesure finira par se détruire elle-même", mais rendu plus ou moins inoffensif par l’ironie qui affleure en bien des points (par exemple dans la discussion entre le président américain et le patron de l'URSS). Romain Gary est-il ici très sérieux ? Au moment de la publication, il n'a plus rien à démontrer (il se suicide trois ans après), et il semble ici se moquer de donner à son roman à thèse la cohérence d'une forme achevée.
Comme si Charge d'âme était un roman testamentaire.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : une coquille marrante page 275 : « ... certains accumulateurs étaient utilisés comme tours de gué ; ... ».
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, romain gary, romain gary charge d'âme, éditions gallimard, collection pléiade, mao tsé toung, michel houellebecq, bombe atomique, écologie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, günther anders, l'obsolescence de l'homme
mardi, 16 avril 2019
LA LARME TRANSPARENTE
Une larme de verre pour Notre-Dame de Paris.
A tort ou à raison, j'ai pensé à Charlie Hebdo, j'ai pensé au Bataclan, j'ai pleuré.
Je pense aussi au Bourdon de Notre-Dame, Emmanuel (eh oui !), qu'on peut entendre tous les jours à 12 heures tapantes. Une expérience qui ne s'oublie pas (1'03"). Il faut se placer à l'aplomb des abat-sons, pas trop près de la façade (clocher de gauche, si je me souviens bien).
Et pour les passionnés (20') : il faut être patient, car le batail (le mot a disparu, mais c'est comme ça qu'on disait dans les autres fois, cf. Rabelais, qui fait parler Maître Janotus de Bragmardo (Gargantua, XIX) : « ... il désiroit qu'elles [les cloches] feussent de plume et le batail feust d'une queue de renard », c'est-à-dire des cloches qui ne réveilleront jamais personne) met pas mal de temps à se mouvoir. L'autre bourdon s'appelle, dit-on, La Savoyarde.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, notre dame de paris, charlie hebdo, bataclan, rabelais, gargantua, maître janotus de bragmardo, littérature française
mercredi, 20 mars 2019
J'AI LU SÉROTONINE 4
 Pour rappel : J'ai lu Sérotonine 1 et J'ai lu Sérotonine 2.
Pour rappel : J'ai lu Sérotonine 1 et J'ai lu Sérotonine 2.
Considérations d'un lecteur ordinaire (fin).
Camille entre dans la vie du narrateur à la page 161 du roman. Elle est citée dès la page 11, mais ne fait réellement irruption dans le paysage qu’au moment où Florent se la remémore : chargé par sa hiérarchie de promouvoir les fromages de Normandie (camembert, livarot, pont-l’évêque), une mission "pour du beurre" en réalité, il est amené à servir de tuteur, lui qui vient d'Agro, à une jeune stagiaire de l’Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort, qu’il vient attendre à sa descente de train, à la gare de Caen.
En l’attendant, il est atteint d’ « un cas de précognition bizarre » : dans une curieuse juxtaposition, il remarque les herbes et les fleurs jaunes qui poussent entre les rails (« végétation spontanée en milieu urbain »), dans le même temps qu’il aperçoit le « centre commercial "Les bords de l’Orne" ». En quoi est-ce bizarre ? en quoi une précognition ? se demande le lecteur. Toujours est-il qu'il s'attend à quelque chose d'au moins inhabituel.
Je remarque au passage un point du style de Michel Houellebecq, qui se débrouille toujours pour éteindre toute velléité d’élan sentimental ou lyrique, en posant à côté de l’ébauche de celui-ci une notation triviale. Une sorte de « romantisme refusé », qui induit une lecture déceptive (probable origine des nombreuses critiques du style, souvent jugé "plat", de Houellebecq). Sa conception, peut-être, du « roman sentimental » qu’il annonçait explicitement dans les médias en 2015, après Soumission. Ce sont peut-être ces impuretés qui font dénoncer à beaucoup de gens en général, et à Antoine Compagnon en particulier, cette « langue plate et instrumentale » (Le Monde, 4 janvier 2019), qui ne se demandent même pas si cet effet produit par la lecture n'est pas exactement celui que l'auteur voulait provoquer. Comme quoi on peut être professeur au Collège de France et connaître des pannes de courant.
« Lorsqu’elle me dit après un temps très long, dans lequel cependant n’existait aucune gêne (elle me regardait, je la regardais, c’était absolument tout), mais lorsqu’elle me dit, peut-être dix minutes plus tard : "Je suis Camille", le train était déjà reparti en destination de Bayeux, puis de Carentan et Valognes, son terminus était en gare de Cherbourg » (p.162). Economie des moyens, surtout ne pas trop en dire, affubler l’événement sentimental de défroques banales pour qu’il passe inaperçu : Houellebecq semble s’être demandé comment renouveler la scène du coup de foudre. Il enchaîne : « Enormément de choses, à ce stade, étaient déjà dites, déterminées, et, comme l’aurait dit mon père dans son jargon notarial, "actées" » (ibid., toujours ces impuretés).
Labrouste se perd alors dans des considérations bassement terriennes sur l’installation de Camille à Caen pour le temps de son stage. La réponse de Camille vaut son pesant de surprise émerveillée : « Elle me jeta un regard bizarre, difficile à interpréter, mélange d’incompréhension et d’une sorte de compassion ; plus tard elle m’expliqua qu’elle s’était demandé pourquoi je me fatiguais à ces justifications laborieuses, alors qu’il était évident que nous allions vivre ensemble » (p.163). Elle au moins elle sait. La messe est dite : Camille est la femme de sa vie. Ou du moins elle aurait dû le rester, s’il avait su. S’il avait pu.
Tout en étant incapable d'en tirer la seule conclusion logique (l'engagement définitif dans la vie à deux), il perçoit bien ce qu’il représente aux yeux de cette étudiante de dix-neuf ans : « … et j’étais bouleversé, chaque fois que je lisais dans son regard posé sur moi la gravité, la profondeur de son engagement – une gravité, une profondeur dont j’aurais été bien incapable à l’âge de dix-neuf ans » (p.179). Il sait aussi que cet amour qui a quelque chose d’absolu le comble. L’un de leurs « rites » est de dîner le vendredi soir à la brasserie Mollard : « Il me semble qu’à chaque fois j’ai pris des bulots mayonnaise et un homard Thermidor, et qu’à chaque fois j’ai trouvé ça bon, je n’ai jamais éprouvé le besoin, ni même le désir d’explorer le reste de la carte » (p.178, les bulots et le homard n'étant là que pour signifier qu'il ne demande rien de mieux à la vie que d'être là, avec cette femme-là).
C'est là que le livre atteint son point culminant (on est exactement à la moitié), la suite sera une longue pente descendante. Le grand amour : « Je ne crois pas me tromper en comparant l'amour à une sorte de "rêve à deux" » (p.165) ; « J’étais heureux, jamais je n’avais été aussi heureux, et jamais plus je ne devais l’être autant » (p.172) ; « … seuls face à face, pendant quelques mois nous avions constitué l’un pour l’autre le reste du monde … » (p.173) ; « … et il me paraît insensé aujourd’hui de me dire que la source de son bonheur, c’est moi » (ibid.). Pour dire le vrai, cet amour le dépasse. De leurs moments de bonheur, il garde seulement deux photos, dont une prise dans la nature, quand elle s’occupe de lui, agenouillée : « … je n’ai plus jamais eu l’occasion de voir une telle représentation du don » (p.174). Et il suffit qu'elle vienne vivre avec lui pour qu'il se rende compte que seule cette femme sait faire de la maison qu'il occupe un lieu vraiment habitable.
Oui, mais c’est lui qui n’est pas à la hauteur. On a compris : Sérotonine est un roman d’amour, mais un roman de la déception, voire du paradis perdu. Pas la déception de l’amour, mais de constater l’impossibilité de l'amour dans ce monde-là. Et là, ce n'est plus seulement l’individu Florent-Claude Labrouste qui est responsable : c’est la société : « … j’avais bien compris, déjà à cette époque, que le monde social était une machine à détruire l’amour » (p.173). Je n’ai pas envie de peser les autopsies respectives de ce qui, dans Sérotonine, relève de l’individu, de la société et de la civilisation, je crois que, dans l’entreprise de Houellebecq, tout cela forme un tout, et je n’ai guère de goût pour le médico-légal. Il faut ici considérer l’individu comme une métaphore (plutôt une métonymie, d'ailleurs, si je me souviens bien, peut-être même une synecdoque, allez savoir).
Ce qui est sûr, c’est que le narrateur de Sérotonine s’inscrit dans une problématique qui dépasse la dimension individuelle de Florent-Claude Labrouste, cet être finalement sans consistance et baladé par les circonstances : « Plus personne ne sera heureux en Occident, pensa-t-elle », p.102 ; « …une civilisation meurt juste par lassitude … », p.159 ; « La France, et peut-être l’Occident tout entier, était sans doute en train de régresser au "stade oral" », p.323. L’individu est peut-être libre, au moins en partie, et peut espérer se construire lui-même s’il en a la force et la volonté, mais il ne pourra s’abstraire du cadre dans lequel il a grandi et qui l’a au moins en partie fabriqué : la société, la civilisation.
Je crois que Florent-Claude Labrouste, dans l’esprit de Michel Houellebecq, est la figure quintessentielle de ce pauvre individu de sexe masculin que produit à la chaîne la civilisation occidentale. Il est à l’image de cette civilisation : impuissant à faire que la vie des gens soit guidée par la puissance de l’amour. Ce dont le héros ne se remet pas. C'est le docteur Azote, une trouvaille romanesque d'une force extraordinaire, qui lui déclare : « J'ai l'impression que vous êtes tout simplement en train de mourir de chagrin » (p.316). Il faut entendre tous les propos que tient ce médecin carrément atypique au pauvre narrateur livré aux aléas du destin. On pourrait presque lire Sérotonine juste pour le docteur Azote (pas vrai, bien sûr, mais).
Aymeric (l'héritier aristocrate et paysan qui se suicide devant les caméras de la télévision) non plus ne se remet pas de l'échec de son couple, ni du sort réservé à la paysannerie française par « les standards européens » (« … et l’Union européenne elle aussi avait été une grosse salope, avec cette histoire de quotas laitiers … », p.259). Seules les femmes maintiennent un semblant de mémoire de l'espèce humaine : « ... enfin elles faisaient plus qu'honnêtement leur travail d'érotisation de la vie, elles étaient là mais c'est moi qui n'étais plus là, ni pour elles ni pour personne, et qui n'envisageais plus de l'être » (p.324).
Les individus sont les jouets de « mécanismes aveugles dans l'histoire qui se fait » (Jaime Semprun), impuissants à prendre en main la trajectoire de leur vie et incapables de s’engager durablement quand l’amour se présente, comme la civilisation occidentale qui leur sert de cadre et de destin est impuissante à donner naissance à un monde conduit par la force de l’amour, c’est-à-dire à donner à l’existence des individus un autre sens que la "fonction sociale" qu'ils sont sommés d'assurer. Une civilisation qui a dévoré « le sens de la vie », la vidant de toute raison d'être. Une civilisation qui, avec l'aide indéfectible des sciences humaines, vidange la substance vivante des individus dans la grande machine à produire du pouvoir et du profit.
Une civilisation qui a, grâce à la grande marchandisation de tout, réduit l'amour véritable à une simple « activité sexuelle ».
Et ce genre de système porte un qualificatif infamant, que je dédaigne ici de prononcer.
Voilà ce que je dis, moi.
Notes : 1 - Petite remarque à l'auteur : la carabine Steyr Mannlicher HS50, dans la position du tireur couché, ne repose pas sur un « trépied » comme indiqué p.232, mais sur un bipied.
2 - Autre petite remarque, à propos d'une « édition intégrale du marquis de Sade » (p.281) : je doute que les "fioritures dorées" figurent sur la "tranche", comme indiqué : ce genre de décor se trouve plutôt sur le "dos" du livre.
3 - J'aime bien le « J'aimerais mieux pas » de la page 309, simple et rapide clin d’œil au "I would prefer not to", d'un héros bien connu de la littérature (le Bartleby d'Herman Melville).
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, sérotonine, impuissance sexuelle, florent-claude labrouste, monique canto-sperber la fin des libertés, éditions flammarion, stendhal armance, antoine compagnon, journal le monde, collège de france
mardi, 19 mars 2019
J'AI LU SÉROTONINE 3
 Pour rappel : J'ai lu Sérotonine 1 et J'ai lu Sérotonine 2.
Pour rappel : J'ai lu Sérotonine 1 et J'ai lu Sérotonine 2.
Considérations d’un lecteur ordinaire.
Jean-Luc Porquet a beau consentir à Michel Houellebecq, dans Le Canard enchaîné du 2 janvier, qu’avec Sérotonine il « parvient à saisir un peu de la vérité du monde », et convenir qu’il a raison, parlant des agriculteurs, au sujet du « plus gros plan social à l’œuvre à l’heure actuelle », il n’a pas, mais vraiment pas du tout aimé le roman, « oubliable et lugubre ». Je lui laisse son opinion. Je ne suis d’ailleurs pas sûr que Houellebecq veuille qu’on aime Sérotonine, sans doute se contente-t-il d’être satisfait d’en vendre un maximum d’exemplaires.
Je ne suis même pas sûr qu’il veuille en général se faire aimer, lui, et après tout ça le regarde. Pour ma part, je ne suis pas sûr d’ « aimer » Sérotonine : je me contente de le trouver d’une effroyable justesse dans le regard qu’il porte sur le monde actuel. Je ne me demande même pas ce que ça vaut en tant que littérature. Car Sérotonine est, selon moi, comme Armance de Stendhal, le roman de l’impuissance (« Les effets secondaires indésirables les plus fréquemment observés du Captorix étaient des nausées, la disparition de la libido, l’impuissance.
Je n’avais jamais souffert de nausées », p.12 ; « Qu’est-ce que nous pouvons, tous autant que nous sommes, à quoi que ce soit ? », p.326), et pas seulement de celle de l’individu Florent-Claude Labrouste, narrateur et personnage principal, qui a été incapable de donner à sa vie quelque inflexion de ce soit. C’est aussi l’échec d’une société, voire d’une civilisation, dont plus personne n'est en mesure de dire où va l'humanité, l'entière humanité désormais embarquée dans un seul navire. Qui est capable de donner au monde actuel quelque inflexion que ce soit ? Quel capitaine pour donner le cap ?
Totalement infirme de la volonté, le narrateur a lâché les rênes, et laisse le hasard guider son existence (« Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots », dit Rimbaud). Il annonce très vite la couleur, et de la façon la plus précise, raison pour laquelle je cite tout le passage : « Mais je n’ai rien fait, j’ai continué à me laisser appeler par ce dégoûtant prénom Florent-Claude, tout ce que j’ai obtenu de certaines femmes (de Camille et de Kate précisément, mais j’y reviendrai, j’y reviendrai), c’est qu’elles se limitent à Florent, de la société en général je n’ai rien obtenu, sur ce point comme sur tous les autres, je me suis laissé ballotter par les circonstances, j’ai fait preuve de mon incapacité à reprendre ma vie en main, la virilité qui semblait se dégager de mon visage carré aux arêtes franches, de mes traits burinés n’était en réalité qu’un leurre, une arnaque pure et simple – dont, il est vrai, je n’étais pas responsable, Dieu avait disposé de moi mais je n’étais, je n’étais en réalité, je n’avais jamais été qu’un inconsistante lopette, et j’avais déjà quarante-six ans maintenant, je n’avais jamais été capable de contrôler ma propre vie, bref il paraissait très vraisemblable que la seconde partie de mon existence ne serait, à l’image de la première, qu’un flasque et douloureux effondrement » (p.11-12). Le « programme » du roman est explicite dès le début : on ne peut pas dire que le romancier dore la pilule au lecteur.
Le personnage du narrateur est donc dans un laisser-aller fatal. On fera une exception au sujet de Yuzu, la Japonaise pornographique et maniaque du maquillage (elle passe six heures par jour à s’appliquer dix-huit sortes d’enduits : « Elle était comme d’habitude impitoyablement maquillée … », p.24) qui partage sa vie au début du livre : pour une fois, il prend une grande décision. Après avoir brièvement envisagé de la défenestrer ou de la trucider au cours d’une de ces partouzes canines dont elle est friande, mais pesé les conséquences légales, il prend le parti de la laisser tomber, purement et simplement, et de disparaître sans laisser d’adresse, en la laissant se dépatouiller quand il faudrait payer le loyer.
Il n’a pas grand-chose à emporter : « J’avais préparé ma valise dès la veille, je n’avais plus rien à faire avant mon départ. Il était un peu triste de constater que je n’avais aucun souvenir personnel à emmener : aucune lettre, aucune photo ni même aucun livre, tout cela tenait sur mon Macbook Air, un mince parallélépipède d’aluminium brossé, mon passé pesait 1100 grammes » (p.79). J’imagine qu’un smartphone d’élite peut faire mieux que ça en termes de poids.
Disparaître, en France, n’est pas interdit : « … l’abandon de famille, en France, ne constitue pas un délit. (…) Il était stupéfiant que, dans un pays où les libertés individuelles avaient d’année en année tendance à se restreindre, la législation ait conservé celle-ci, fondamentale, et même plus fondamentale à mes yeux, et philosophiquement plus troublante, que le suicide » (p.59). D’accord en ce qui concerne la restriction des libertés individuelles (voir La Fin des libertés, de Monique Canto-Sperber, qui vient de paraître). Ne doutons pas que la lacune juridique du droit français sera bientôt comblée.
Il prend donc le droit de disparaître (voir Disparaître de soi, de David Le Breton, aux éditions Métailié, où la chose est décrite comme un fait de civilisation), c'est d'ailleurs la morale définitive qu'il semble tirer de toute son existence : « De mon côté, avant de franchir la porte, je m'excusai du dérangement, et au moment où je prononçais ces mots banals je compris que c'était à cela, maintenant, qu'allait se résumer ma vie : m'excuser du dérangement » (p.327).
L’impuissance dont parle Sérotonine est donc celle d’un personnage. Mais l’impuissance sexuelle dont souffre le narrateur dans le présent de l’action se double d’une autre impuissance, et bien plus grave. Celle-ci n’est plus d’ordre médical, mais moral, sur le plan individuel, mais aussi, on le verra, anthropologique. Florent-Claude Labrouste, n’a jamais été en effet capable de faire face au véritable amour quand les circonstances l’ont mis en présence, d’abord de Kate, qui l’écrase de son intelligence mais qu’il laisse un jour en larmes, sur un quai de gare pour rentrer en France.
Ensuite de Camille, la femme de sa vie, la plus belle histoire de ses amours qui, par la faute de sa faiblesse de caractère, finira bêtement et tristement. Au fond, il ne s'engage jamais complètement dans ce qu'il fait. Il est très bien payé, comme contractuel au ministère de l’Agriculture, en tant qu’ancien d’Agro, mais en même temps qu’il quitte Yuzu, il disparaît aussi sans problème du paysage de son employeur, alors même que son supérieur juge ses rapports clairs et intéressants (« vous êtes un de nos meilleurs experts », p.61), en racontant des salades sur fond de concurrence mondialisée des compétences : « En somme, vous passez à l’ennemi … » (ibid.).
De même, il foire un jour sa grande aventure avec Camille, quand il tombe nez à nez avec elle en sortant de l’hôtel main dans la main avec une femme (Tam) qu’il a croisée dans le cadre professionnel et qui ne compte guère dans son existence. Un malheur, mais révélateur de sa trajectoire personnelle, livrée aux occasions qui se présentent et à l’improvisation d’un temps présent sans mémoire et sans projet.
Voilà ce que je dis, moi.
Suitetfin demain.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, sérotonine, impuissance sexuelle, florent-claude labrouste, monique canto-sperber la fin des libertés, éditions flammarion, stendhal armance, jean-luc porquet, le canard enchaîné, david le breton, éditions métailié, david le breton disparaître de soi
samedi, 02 mars 2019
J'AI LU SÉROTONINE 2
2 – Le livre.
Ce que je retiens de la lecture de Sérotonine.
Drôle de lecture, quand même. Pensez, après avoir refermé le livre de Michel Houellebecq, un jour où je furetais dans les rayons de la librairie Vivement dimanche, je suis tombé sur un petit ouvrage de David Le Breton que j’ai acheté aussitôt.
Et cela au seul motif qu’il s’intitule Disparaître de soi (Métailié, 2015). Rendez-vous compte : exactement les mots que j’avais écrits au crayon à la lecture de Sérotonine en face de cette phrase : « Je parvenais à me brosser les dents, ça c’était encore possible, mais j’envisageais avec une franche répugnance la perspective de prendre une douche ou un bain, j’aurais aimé en réalité ne plus avoir de corps, la perspective d’avoir un corps, de devoir y consacrer attentions et soins, m’était de plus en plus insupportable … » (p.92). En fait j’avais souligné "j’aurais aimé ne plus avoir de corps" avant d’inscrire la formule dans la marge.
Pour terminer sur la circonstance, j’ai lu le livre de Le Breton, et j’ai compris pourquoi les sciences humaines en général et la sociologie en particulier souffrent d’une infirmité génétique irrémédiable par rapport à la littérature : l’universitaire produit un livre de tâcheron qui commence par une compilation laborieuse de cas pris généralement dans la littérature (ici le Bartleby d'Herman Melville, Robert Walser, Fernando Pessoa, etc.) et se rapportant au thème que l’auteur s’est choisi, cas dont il fait consciencieusement l’autopsie de façon finalement médico-légale, et où il arrive à lâcher une énormité en faisant de la disparition de soi « une expression radicale de liberté » (p.49 et sans explication). Est-ce que l'impossibilité de se plier à l'observance d'un code est pour autant une expression radicale de liberté ? J'en doute fort, au moins ça se discute.
Heureusement, la suite évite de me faire trop regretter mon achat : l'auteur associe de façon plus convaincante des "faits sociaux" typiques de notre époque, qui montrent le vampirisme effréné d'un système qui vise à vider l'individu de sa substance personnelle (et je ne pense pas seulement à la commercialisation des données personnelles par les "GAFA"). Reste que la littérature est seule à être en mesure de réaliser l'unité du savoir humain. Et que la "disparition de soi" dont la société actuelle nous parle n'est pas l'expression d'un choix, mais l'effet d'un puissant processus de civilisation. Elle nous l'impose.
Sérotonine s’oppose au Disparaître de soi de Le Breton un peu comme les physiciens opposent matière et antimatière. Oui, le bonhomme que met en scène Houellebecq est vide et nul (« …enfin je m’égare revenons à mon sujet qui est moi, ce n’est pas qu’il soit spécialement intéressant mais c’est mon sujet », p.181), il est dans une profonde dépression, dans un état de déréliction pitoyable, il se laisse aller, il ne croit plus en rien, il n’a même plus de désir.
Mais l’étonnant, c’est que dans ce récit d'une déconfiture morale, psychologique et humaine, le romancier parvient à donner à son personnage de Florent-Claude Labrouste, en en faisant une sorte d’anti-Vautrin (le personnage de Balzac est tout en force redoutable, même quand il se fait coffrer par un flic, alors que Sérotonine raconte un naufrage de la première à la dernière page), une existence littéraire spectaculaire et puissante. L'effet de présence est étonnant. Pas à la portée de la première Christine Angot venue.
C’est peut-être ce qui défrise les ennemis de Houellebecq : il élève un superbe monument à la Négation. Il s'en prend aux raisons de vivre (aux "valeurs") communément admises par la communauté des croyants, je veux dire les idolâtres du "Progrès". Les œuvres de Houellebecq, en commettant cette infraction, illustrent assez bien ce que Philippe Muray désigne comme l’enfer des bonnes intentions porté par la modernité, qui est l’évacuation pathologique du tragique inhérent à l’existence humaine : la négativité, autrement dit le Mal. Ce qui se prétend moderne et progressiste aujourd’hui a juste balayé sous le tapis rutilant du "Progrès" (= l’empire du Bien selon Muray) la poussière de sa propre négativité. Et réprime sans pitié tout ce qui met le doigt dessus pour le désigner comme telle.
Et le paysage de ce désastre d’une civilisation (« Plus personne ne sera heureux en Occident, pensa-t-elle », p.102 ; « …une civilisation meurt juste par lassitude … », p.159 ; « La France, et peut-être l’Occident tout entier, était sans doute en train de régresser au "stade oral" », p.323) défile devant le lecteur avec la clarté de l’évidence, dans une narration qui coule sans heurt, avec une régularité, une fluidité qui rendent le récit incontestable et sa « vérité » d’autant plus tangible. J’avais eu la même impression à la lecture de Soumission : une coulée irrésistible. Il y a là un savoir-faire d’autant plus redoutable que les caractéristiques du personnage du narrateur rendent bien compliqué le processus d’identification, ce ressort habituel du romanesque qui donne au lecteur l’impression de se trouver dans l’action.
Houellebecq a trouvé là un moyen « non-brechtien » de pratiquer la « distanciation » : il faut le faire ! Brecht, pour cela, n'hésitait devant aucune grossièreté intellectuelle : il montrait les rouages de la machine théâtrale au sein même de l’action théâtrale : cela suffisait, pensait-il, pour que le spectateur se sente moins « dans l’histoire » que dans une salle bien concrète, où il ne devait jamais perdre de vue qu’un acteur est un acteur, et non le personnage qu’il joue. Tout ça parce que le public ne devait jamais perdre de vue la problématique sociale de l’œuvre et son lien avec la réalité économique et politique : c'était du théâtre militant. Houellebecq n'est pas un militant : il regarde le monde. Il a cessé d'avoir envie de le changer. C'est du réalisme.
Le lecteur accompagne donc Florent-Claude Labrouste dans son naufrage, décrit comme une sorte de mécanique fatale, et auquel le personnage et le lecteur assistent impuissants. Sérotonine est peut-être (entre antres) le roman de l’impuissance : « … je compris que le monde ne faisait pas partie des choses que je pouvais changer … », p.182 ; « … décidément on ne peut rien à la vie des gens, me disais-je, ni l’amitié ni la compassion ni la psychologie ni l’intelligence des situations ne sont d’une utilité quelconque … », p.222-3 ; « Qu’est-ce que nous pouvons, tous autant que nous sommes, à quoi que ce soit ? », p.326. On conçoit que cette litanie des aveux heurte de plein fouet la morale de la volonté inculquée par la tradition chrétienne, selon laquelle « quand on veut on peut », socle d’une conviction du pouvoir de la volonté (= de la liberté) individuelle partagée par toute une civilisation.
L’impuissance masculine du héros, dans l’Armance de Stendhal (le « babilanisme »), est une exception, un cas particulier, elle a quelque chose d’accidentel et d’infâme. Florent-Claude Labrouste subit certes cette impuissance sexuelle (quoique de nature médicamenteuse, induite par le Captorix, cet antidépresseur qui réduit à néant la libido), mais c’est aussi celle, beaucoup plus générale, de « l’homme occidental » (p.87) : les femmes quant à elles (attention : seulement quand elles sont jeunes et fraîches) maintiennent éveillé l’instinct de reproduction et continuent à faire « plus qu’honnêtement leur travail d’érotisation de la vie » (p.323). Et au-delà même de la défaite des hommes, l’impuissance dont parle Houellebecq est aussi celle de la civilisation occidentale.
La civilisation de l'Occident règne sur le monde, et le roman de Houellebecq met précisément le doigt là où ça fait le plus mal : si cette civilisation finit, c'est le monde qui finit.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre, prochainement.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, houellebecq sérotonine, houellebecq soumission, sciences humaines, sociologie, david le breton, le breton disparaître de soi, éditions métailié, bartleby, robert walser, fernando pessoa, florent-claude labrouste, philippe muray, l'empire du bien, impuissance masculine, stendhal armance, captorix, christine angot



